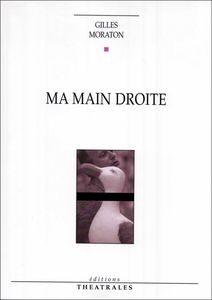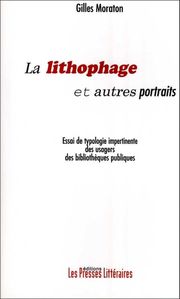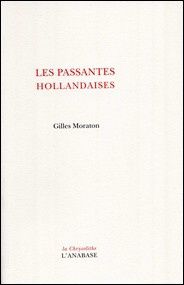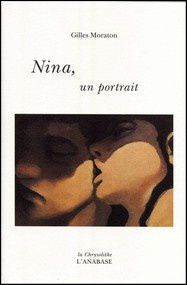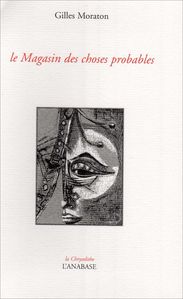LOCATAIRES SUCCESSIFS DE LA MAISON DE VACANCES SITUEE AU 29, RUE DES VOISINAGES HARMONIEUX A SAINT-PIERRE-LA-MER, EN FRANCE, DANS LE DEPARTEMENT DE L'AUDE (FIN XXe-DEBUT XXIeSIECLES)
[NOTE PRELIMINAIRE 1 : Cette maison de vacances a été érigée dans une station de vacances, au sein d'un lotissement de vacances, vers le milieu des années soixante, dans une époque où il était indifférent aux autorités de sacrifier des espaces naturels aux prétendus besoins d'évasion créés par la monotonie de la vie citadine. Chacun, dans ces cas-là, souhaitant voir de sa fenêtre dès le matin l'horizon de la méditerranée, chacun souhaitant n'avoir que quelques pas à faire pour y plonger son corps, chacun souhaitant pouvoir retrouver un semblant de vie sauvage en disposant à tout moment de la journée de la possibilité de faire cuire des sardines au charbon de bois sous le linge étendu des voisins, le projet de construction du lotissement s'était en toute logique nommé « Front de mer », ce qui avait eu l'avantage d'en faire vendre les parcelles en quelques jours, alors que les propopèles et les phlatifrages couvraient encore le sol. Le métreur du projet avait d'ailleurs lui-même acquis une dizaine de lots pour son propre compte avant que le prix des terrains ne fut multiplié par cent cinquante, car le délit d'initié n'existait pas encore, du moins il n'était encore guère risqué de le pratiquer. Mais de front de mer avec vision directe sur la calme étendue maritime, il n'en fut finalement question que pour le vasistas de la salle de bains des dix maisons en bout d'alignement des cinquante quatre autres, car pour rentabiliser l'espace pris sur la nature l'alignement des maisons avait été disposé en épi plutôt que face à la mer. On l'aura compris les dix maisons en question avaient été construites sur les parcelles acquises par le métreur, ce qui aurait pu leur donner une plus value incontestable si le promoteur n'avait décidé d'équiper les salles de bains de fenêtres fixes (c'est à dire impossibles à ouvrir) et ne les avait pourvues de vitres en verre dépoli. Mais de cela, notre métreur se moquait comme de ses dents de lait, étant donné que les maisons furent revendues à l'unité à peine construites. Celle qui nous intéresse ici, située, donc, au 29 rue des voisinages harmonieux et dont la fenêtre de la salle de bains pourrait donner sur la mer si elle s'ouvrait, faisait partie de ce lot. Elle comprend une pièce – que l'on pourrait qualifier de grande en comparaison avec les autres espaces –, en forme de couloir un peu large tenant lieu de salle de séjour-salle à manger, prolongée en son extrémité d'une cuisine aménagée et surmontée à mi hauteur d'une mezzanine sur laquelle on peut faire tenir un matelas. Une échelle de meunier en pin conduit à l'étage où se trouve une chambre et une salle de bains dont la fenêtre pourrait donner sur la mer si elle n'était scellée. ]
[NOTE PRELIMINAIRE 2 : La maison fut revendue le 14 octobre 1969 à Marcel Folant propriétaire récoltant sur la commune de Marcorignan (Aude) qui investit dans cet achat toutes ses économies ; il se refusa à la louer la première année car il était honnête homme et ne souhaitait pas faire vivre des estivants dans des odeurs de peintures et de plâtre encore mal séchés. Marcel Folant bichonna sa maison de vacances plus que la sienne propre, ne tenant à prêter le flanc à aucune critique, il la meubla de meubles neufs, ou du moins en excellent état, ce qui n'était pas le cas, loin s'en fallait, des maisons voisines, équipées à la va-comme-je-te-pousse, d 'éléments parfois même récupérés dans des décharges municipales, il l'a vu des ses yeux, il l'a même entendu dans la bouche d'un de ses voisins-propriétaires, on va pas s'emmerder pour des parisiens qui sont là un mois par an – un argument, bien entendu, à même de justifier toutes les dérives. Quoi qu'il en soit la période de rentabilisation de l'achat de Marcel Folant débuta avec la famille Bringuier au mois de juillet 1970, pour la somme de deux mille cinq cents francs le mois, Monsieur Folant réservant le mois d'août pour sa propre famille, comme il le fera chaque année jusqu'à son décès, le 20 novembre 2010. Il aurait pu tomber, comme cela arrive parfois, sur un de ces couples qui, leur vie durant se rendent en vacances au même endroit, cela lui aurait simplifié la gestion de ses locations mais ce ne fut pas le cas.]]
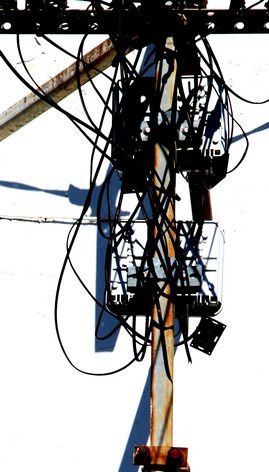
JUILLET 1970 à JUILLET 1976 – COUPLE BRINGUIER
Diane et Jean Bringuier ont tous deux vingt-huit ans en juillet 1970. Ils se sont mariés quatre ans auparavant et ne sont pas parisiens – mais ils seront par tous ici qualifiés de parisiens en raison de leur accent, ou plutôt en raison de leur absence d'accent local. Ils n'ont pas d'enfant et ne souhaitent pas en avoir car, prétendent-ils « ce serait un crime que de mettre au monde un enfant pour le livrer aux forces capistalistiques d'oppression, il vaut mieux écouter Carlos Santana et Jimy Hendrix en fumant de l'afghan ». Ils sacrifient mollement à la mode des vacances en bord de mer à la seule raison d'inviter des amis et de se livrer avec eux à toute sorte de jeux sexuels, c'est leur conception des vacances, une période qui permet d'engranger des souvenirs pour le reste de l'année. Les voisins parfois se sont plaints de voir déambuler des gens nus à travers la baie vitrée donnant sur le jardinet de devant, mais ils s'en moquent, ils n'ont que ces trente jours avant de replonger dans la grisaille et le crachin – ce qui ne les empêchera pas, même en hiver, même dans leurs périodes laborieuses, d'écouter Carlos Santana et Jimy Hendrix en fumant de l'afghan.
Diane Bringuier enseigne la littérature du 19e siècle à l'université, en égrenant à longueur de cours les atermoiements d'Emma Bovary, ou en balayant le champ sociologique couvert par l'indifférence affichée du Frédéric de l'Education sentimentale – c'est aussi au sein de cette même université qu'elle se fournit en afghan et souvent, en compagnons de jeux sexuels. Jean Bringuier est représentant de commerce, il va sur les routes pour essayer de vendre à des paysans bougons ou à des épicières alanguies des chemises et des pantalons de Tergal à la coupe et aux coloris passés depuis des années. C'est ainsi que Jean, recrute parfois ses ami(e)s de vacances, en proposant à ses meilleures clientes de les rejoindre quelques jours sur la côte.
Lors de l'été 1976, pendant une de leurs fêtes décadentes, Diane Bringuier s'entiche d'un trompettiste d'orchestre et quitte Jean Bringuier au prétexte que lui au moins (le trompettiste), il sait s'y prendre, sous-entendant par là que ce dernier excellait dans l'art du cunnilingus, la pratique favorite de Diane, ce que Jean avait toujours considéré comme une habitude exécrable lui coupant toutes ses envies – et bien que cette pratique le laissât toujours au bord de la nausée, il y sacrifiait cependant de temps en temps pour faire plaisir à sa compagne, c'est la raison pour laquelle il n'accepta jamais ce fallacieux argument. Jean tombera ensuite dans la dépression et ne sera sauvé de la déchéance que grâce au trompettiste qui lui présentera une choriste de laquelle il (Jean) tombera amoureux immédiatement, cela s'appelle un coup de foudre, il en va ainsi de la triviale condition humaine.
Cette rupture dans le couple Bringuier mettra un terme à leurs vacances estivales, balnéaires et libidineuses.
JUILLET 1977 à JUILLET 1983 – FAMILLE ASTRAUP
Michel Astraup est un ancien ouvrier qui a réussi à force de travail à se hisser au rang, inimaginable en début de carrière, de contremaître de classe exceptionnelle – il s'agit d'un grade, non d'un état. Contremaître de classe exceptionnelle à La Montagnarde, une usine de pièces détachées pour machines agricoles. Qu'un ouvrier ne prenne pas de vacances, cela semblait naturel mais il n'en allait pas de même d'un contremaître, un contremaître se devait de faire bonne figure – ne serait-ce que pour en mettre plein la vue à la masse de ses congénères restés ouvriers. Ainsi, après douze années de congés payés passés devant le Tour de France – tandis que les enfants étaient envoyés en colonie de vacances grâce aux subsides de la mairie –, Michel Astraup avait pris le taureau par les cornes et décidé que c'était terminé, maintenant qu'il était presque cadre il devait partir en vacances. Lui et sa famille. N'importe où mais partir. Dans n'importe quelles conditions mais partir.
Il ne gagnait pas assez pour acheter une caravane ?
Et alors ? La belle affaire.
Une location, la 504, la mer.
Simple.
Simplissime.
Où était le problème ?
Qui avait parlé de problème ?
Il n'y avait pas de problème.
C'est ainsi que la famille Astraup – de Francine, l'épouse légitime, il ne sera pas question ici car elle n'a aucun droit de décision dans les affaires familiales, quant aux trois enfants, inutile même de mentionner leur existence –, c'est ainsi que la famille Astraup, au prix d'efforts permanents consentis tout au long de l'année, transita chaque été de son quatre pièces de 80 mètres-carré à cette maison de vacances de quarante trois pour la durée du mois de juillet.
Pour éviter l'étouffante promiscuité de la maison, la mère et les enfants occupaient la plupart de leur temps en allant pêcher à l'épuisette des palourdes qu'ils consommaient le soir même en persillade. Les garçons râlaient en permanence et la fille était empêchée de sortir car trop jeune encore – toujours trop jeune même les années passant, la jalousie du père s'aiguisant en même temps que se développaient les formes de la fille.
Les bains de mer vidaient les énergies et rougissaient les peaux, les parents parfois allaient danser au camping de La Loutre balnéaire sur des musiques d'un autre âge, ils y croisaient d'autres vacanciers qui, comme eux essayaient de se désennuyer en attendant la rentrée, ils y critiquaient ce lieu, tout juste bon pour les vacances mais à la limite on serait mieux ailleurs, ils y retrouvaient parfois des couples rencontrés les années précédentes, bref, la famille Astraup menait sa vie de famille ordinaire en vacances ordinaires.
A partir de juillet 1981 les garçons réussirent à faire accepter à leur père l'idée de planter une tente dans le minuscule jardin à l'arrière de la maison. Outre l'avantage considérable de ne plus entendre le père ronfler, ce dispositif leur permettait de temps en temps de filer en douce écouter les Rolling Stones à « L'oeil », la boîte branchée du coin. L'inconvénient majeur était que la tente se trouvait exposée au soleil dès le matin et qu'ils s'éveillaient inondés de sueur, le jardinet ne se trouvant ombragé ni par des arbres ni par un quelconque store – cela faisait beaucoup rire leur père.
Ce fut cette tente, en juillet 1983 qui fut à l'origine de la fin du rituel annuel de location.
Le 14 juillet 1983, alors que leur fille avait prétexté une fatigue excessive et que, rentrant prématurément de l'absence de feu d'artifice annulé pour cause de trop grand vent, les Astraup père, mère et fils, entendirent ensemble à l'approche de leur maison, ce n'était donc pas un effet de leur imagination, entendirent ensemble en provenance de la tente, les cris de leur fille en proie à une occupation dont la nature ne laissait aucun doute.
L'ambiance des vacances en prit du plomb dans l'aile.
Le père fut conduit à l'hôpital de Narbonne, avec, au cœur, une lésion bénigne mais irrémédiable. A son retour, trois jours plus tard, les bagages furent empilés dans la 504, on ferma la maison et on s'en repartit sans un mot vers l'appartement de Montereau-sur-le-Jard essayer de reprendre dans la douleur une vie normale.
[Dans les jours, les mois, les années qui suivirent, les Astraup ne repartirent plus jamais en vacances ni n'en évoquèrent la possibilité. Un certain nombre de mots, dont on trouvera la liste ci-après, fut définitivement banni du vocabulaire familial – et s'il arrivait que l'un d'eux échappât au cours d'une conversation ou pendant un repas, le père aussitôt blêmissait et se fermait, rétif à toute tentative de consolation, le regard perdu dans le vague, absent, ailleurs, muré dans ses noires pensées pour un temps proportionnel à la gravité de l'offense à la mémoire.
Ajoutons que cette liste a longtemps été mouvante, jamais close ni arrêtée, et qu'à n'importe quel moment pouvait surgir un vocable nouveau propre à plonger le père dans son état de béatitude prolongée :
plage, tente, 14, juillet, 14 juillet, vent, feu d'artifice, pétard, nuit, nocturne, noir, famille, fille, pétasse, cris, défilé, fête nationale, char d'assaut, camping, vacances, congés, capote, location, canadienne, sardine, piquet, matelas, été, halètements, rue, sexe, sel, mer.]

JUILLET 1983 à JUILLET 1990 – MARCELLE ZANGONIO
Marcelle Zangonio, 37 ans en 1983, comptable dans un cabinet d'expertise en assurances, célibataire sans enfant.
Sans être lubrique ni perverse, mademoiselle Zangonio déployait rituellement durant les mois de juillet la panoplie complète de ses capacités de séduction.
En temps normal, c'est à dire en dehors de ce mois de vacances, elles détestait se frotter contre les hommes, elle détestait leur compagnie, leur odeur, leur sexe dressé et menaçant ; en temps normal elle savait se faire repoussante pour qu'ils ne l'approchent pas et elle y parvenait sans problème : les malheureux impétrants ayant effectué des manœuvres d'approches s'étaient vu traîner dans la boue de la dénonciation publique, accusés parfois de harcèlement pour être arrivés au travail avec un bouquet de fleurs.
Mais en juillet c'était autre chose.
En juillet elle ne se refusait rien.
Ni les laids ni les vieux ni les jeunes. Rien.
Tout ce qui, dans l'engeance humaine s'apparentait à un mâle, quel que fut son état, quelle que fut sa condition, pouvait trouver grâce ses yeux.
En juillet, aucun des employés du cabinet n'aurait reconnu la comptable modèle aux éternels tailleurs-pantalons et aux chignons austères. Ils ne l'auraient reconnue ni dans ses tenues, ni dans ses comportements.
Pour Marcelle Zangonio, les vacances, c'était ça et uniquement ça, un homme différent chaque soir.
Car chaque soir elle rentrait avec un homme différent.
Chaque soir elle se couvrait de transparences qui voilaient à peine son corps et s'en défaisait avec la plus grande facilité.
Chaque soir elle faisait résonner ses cris jusque tard dans la nuit.
La seule condition à ce qu'un homme entrât chez elle – et en elle – étant qu'il soit parti avant qu'elle soit réveillée.
Les frasques de sa locataires coururent les rues et les routes, et arrivèrent jusqu'aux oreilles du propriétaire qui n'y prêta guère attention mais se dit que tout de même, cette maison devait avoir quelque chose, elle attirait le sexe comme d'autres le malheur – à tout prendre, pensa-t-il encore, la chose était plus acceptable que les deux suicides en cinq ans de la rue des Conversations philosophiques.
Mademoiselle Zangonio adorait les statistiques, et au final, avec un total oscillant entre 25 et 30 hommes dans le mois, c'était beaucoup plus que ce dont la plupart des femmes de son âge pouvaient s'enorgueillir pour une année. Sur le plan des statistiques pures, elle était pleinement satisfaite.
En 1990, la moyenne mensuelle étant tombée en dessous de 10, mademoiselle Zangonio décida de mettre un terme à ses aventures estivales et consacra désormais ses vacances à la création d'un herbier francilien.
JUILLET 1991 – JULIETTE ET KARIM BENSAOUI
Le propriétaire, M. Folant, pensait pour une fois avoir trouvé dans le couple Bensaoui des gens ordinaires, normaux, pourrait-on dire, si tant est que cela existe. Ils s'étaient même engagés au moment de la signature du bail à revenir chaque année jusqu'à l'âge de leur retraite qui ne devrait survenir, si tout allait bien, qu'une trentaine d'années plus tard.
Ces gens étaient jeunes et sains, ils gagnaient bien leur vie, et M. Folant pensa également qu'ils devaient avoir des pratiques sexuelles s'inscrivant dans les normes de la bienséance quant au voisinage.
Bien sûr M. Folant ignorait tout des soirées déguisées que le couple pratiquait régulièrement, lui en femme, elle en homme, soirées au cours desquelles il leur arrivait de se blesser cruellement à la seule fin d'augmenter la capacité de jouissance des corps.
Pourtant, ces pratiques se déroulant toujours derrière des rideaux tirés, personne n'y trouva rien à dire car personne n'en fut informé.
Malheureusement pour tous, à la fin de ce premier séjour méditerranéen Juliette et Karim Bensaoui se tuèrent sur la route du retour, leur voiture fracassant un parapet et allant s'écraser sur les rochers trente mètres en contrebas, comme Jean-Louis Trintignant et la voiture de Vittorio Gassman dans Le fanfaron, exactement comme ça.
JUILLET 1992
Avant même d'entrer dans la maison, le 1er août 1992, M. Folant sentit que quelque chose clochait, il en eut l'intuition immédiate, intuition confirmée dès que, après avoir ouvert la porte, il fut confronté au spectacle de sa maison dévastée.
Rien de ce qui pouvait être cassé n'était resté entier.
Partout sur le sol de la vaisselle brisée.
Des lampes renversées, des bibelots émiettés, des couches de bébé usagées jetées n'importe où, des bouteilles d'alcool vides, des paquets de cigarettes, des emballages alimentaires, des mégots de cigarette, des cendriers pleins, des vêtements sales abandonnés, des taches, du vomi, des préservatifs.
La cuisine manifestement n'avait pas été nettoyée du mois. La gazinière présentait sur toute sa surface émaillée une croûte noirâtre qu'il serait impossible de faire revenir, le sol était jonché de détritus, de restes de repas vieux de plusieurs jours, couverts de moisissures, les murs eux-mêmes étaient badigeonnés par endroits de traces douteuses et du frigo resté ouvert dégueulaient des coulures d'un liquide jaunâtre.
L'ensemble baignait dans une odeur âcre de vieille maison fermée depuis des décennies, mêlée aux relents des couches sales.
Cela ne ressemblait pas aux suites d'une bataille mais aux stigmates d'un comportement aux portes de la barbarie.
Il fallut à M. Folant une bonne dizaine de minutes pour émerger de la stupeur.
Même les bêtes souvent nettoient leurs lieux de passage, pensa-t-il.
Ce que M. Folant avait sous les yeux lui fit aussitôt rayer de sa mémoire les noms des occupants de juillet et jusqu'à leur visage. Il se refusait de penser qu'il avait pu faire entrer dans sa maison des gens capables de faire ça.
Qu'il avait pu se tromper à ce point.
Ne voulut plus rien avoir à faire avec eux.
Essaya mais en vain d'arracher la vision de sa mémoire.
Décida en conséquence d'agir le plus vite possible et investit beaucoup plus que ce qu'avait rapporté la location de juillet.
Ce fut la société Cleanrapid qui s'occupa du nettoyage.
La gazinière fut changée, les murs repeints, remplacé le matelas de la mezzanine.
Cette année-là, la famille de M. Folant n'occupa pas la maison au mois d'août.

JUILLET 1993 à JUILLET 1999 – HUGUETTE ET SIMON CARSALADE
En 1993, Huguette et Simon Carsalade ont tous deux autour de la soixantaine. Leur plus grand plaisir est d'organiser chaque soir un apéritif dans le jardinet de la maison où ils invitent tous les voisins qui veulent bien y participer.
Ils amènent chaque année de l'Aveyron une pleine voiture de salaisons de toute sorte.
Huguette se met en quatre, passe souvent une partie de l'après-midi, au lieu de profiter de ses vacances à la plage, à préparer les apéritifs du soir.
Il faut dire que les Carsalade n'aiment guère les joies de la plage et de la baignade en eau de mer, « on rentre du sable dans toute la maison, après » se plaint souvent Huguette ; il ne viennent là, les Carsalade que pour sacrifier à une sorte de rite, simplement parce que Simon a lu un jour dans le Point que ne pas partir en vacances sur le bord de la mer était un signe de pauvreté – et s'il est une chose que déteste Simon c'est donner à penser qu'il est pauvre.
On ne peut pas dire qu'ils soit riche mais de là à être pauvre ça fait deux.
Alors en été, ils partent en vacances, c'est comme ça.
Même si ce sont plutôt des montagnards, ils partent en vacances à la mer.
Quitte à ne pas mettre les pieds à la plage du mois.
Quitte à repartir aussi blancs que ce qu'ils sont arrivés.
Et pour donner quelque sens à ces vacances absurdes, en point culminant à une journée d'ennui et de farniente, sur le coup des 19 heures, Simon sort sur le pas de la porte et hurle à la cantonade : « Paaaaaaaaaastiiiiiis ! »
La première année, il ne lui a fallu que deux ou trois soirs pour rassembler un cercle de fidèles.
En juillet 1999, Huguette et Simon savent tous deux que ce sont leurs dernières vacances ensemble, Simon est atteint d'un mal qui ne lui laissera que quelques mois de vie.
Ils font comme si de rien n'était.
Dans la douleur, ils font comme si de rien n'était.
Vaquent jour après jour à la préparation des apéritifs quotidiens.
Au soir du dernier apéritif, comme chaque année tout le monde s'embrasse en larmes, en se promettant de se donner des nouvelles avant l'année prochaine.
JUILLET 2000
La maison, endommagée par une forte tempête d'hiver n'a pu être louée cette année. Avant d'entamer les travaux – en particulier la réfection du toit – il a fallu que se succèdent divers experts mandatés par la compagnie d'assurance de M. Folant, puis divers artisans pour réaliser les devis nécessaires.
L'affaire ayant traîné plusieurs mois, et les artisans prenant eux aussi des vacances en été, les travaux n'ont pu commencer qu'au mois de septembre.
JUILLET 2001 – GASPARD LEPLEUMELEC
Veuf de fraîche date, Gaspard Lepleumelec s'est décidé à soixante douze ans, après des années d'ascétisme, à « descendre sur la côte mener la grande vie ».
L'expression est de lui.
Il l'a assénée un soir de février à son copain Emile en frappant du plat de la main sur le comptoir du Bar des sportifs repentis, rue des sportifs repentis, à Tilloy-les-Mofflaines, dans le département du Pas de Calais :
— Cet été l'Emile, j'descends sur la côte mener la graaaaande vie !
— La graaaande vie ?
— C'est ça, la grande vie.
Après digestion de la nouvelle dans un silence lourd de sous-entendus, Emile avait dit :
— Mais qu'est-ce t'entends par là, Gaspard, la graaaaande vie ?
— J'te dirai ça au retour.
— Tu déconnes, t'iras jamais.
— J'irai.
— T'iras pas, c'est pas pour nous ces conneries, et d'abord où tu trouverais l'argent ?
— Oh ça, t'inquiète pas, La Mariette, elle est pas partie pour rien, ah ah.
L'incident était clos et il n'avait plus été question entre eux de ce séjour sur la côte jusqu'à ce qu'Emile voit de ses propres yeux son vieil ami monter dans le TGV direct Lille-Montpellier.
Après le départ du train, il en était resté sonné un long moment, anéanti surtout par la perspective de ce mois de juillet à passer dans la solitude.
Peut-être Gaspard Lepleumelec avait-il vu trop de films, ou peut-être s'était-il imaginé autre chose, une vie plus proche de celle menée dans les grands hôtels de la côte d'azur, où les dames, pensait-il, ne se montrent qu'en robe de soirée et où les serveurs, malgré l'écrasante chaleur, officient en veste blanche, tandis que sur la corniche en contrebas circulent les limousines de luxe aux vitres teintées. Une vie de facilité et de romances bon marché.
Au lieu de quoi, Gaspard Lepleumelec fut confronté à longueur de journée à des braillements de bébés déconcertés par la trop grande chaleur, et à longueur de nuits par des fêtards ivres et vulgaires arpentant les rues et la plage en chantant des chansons paillardes.
S'il est une chose que Gaspard Lepleumelec déteste par dessus tout c'est bien la vulgarité et le laisser aller.
Il les observa plusieurs soirs de suite.
Au prétexte des vacances, ces gens apparemment s'accordaient l'autorisation de la régression, ils laissaient la bête en eux poindre le bout de son groin, et mieux valait ne pas être une femme passant à leur portée.
Mieux valait.
Mais un vieux, personne n'y faisait cas.
Au bout d'une semaine il n'en pouvait plus.
Ne trouvait le sommeil qu'au petit matin pour être réveillé deux heures plus tard par la chaleur.
Le moindre cri d'enfant le faisait sursauter.
Pays de fous.
Personne ici ne se contrôlait, on aurait dit que tous s'étaient donné le mot pour péter les plombs.
Pays de fous.
Il n'avait jamais connu pareille chaleur.
Même l'eau de la mer était tiédasse.
Qu'est-ce qu'il allait raconter à l'Emile ?
Il se donna encore une semaine.
Essaya de sortir le soir à la rencontre d'une atmosphère, d'un lieu qui répondrait à ses attentes, peut-être en existait-il un, quelque part. Il sillonna les rues, mais ne fut confronté qu'à des musiques agressives et à des familles abandonnant leurs enfants à eux-mêmes. Ou bien les gavant de glaces pour les faire tenir tranquilles.
Gaspard ne comprenait plus le monde.
L'Emile avait raison, ces conneries c'était pas pour eux.
Il entra tout de même au Saïgon, un soir sur le coup des onze heures, parce que le nom lui rappela un bordel qu'il avait connu autrefois, où il avait croisé parmi les plus belles femmes du monde, mais ici, le Saïgon n'était qu'un restaurant, un simple restaurant qui ne servait plus à cette heure-ci, désolé monsieur, revenez demain, nous vous accueillerons avec plaisir.
Tous les visages de la salle étaient tournés vers lui, avec dans les yeux, cette interrogation muette, à la limite de l'accusation : que fait ce vieux ici à cette heure ?
Il se replia en hâte.
Le lendemain, après deux semaines de séjour, il faisait ses bagages et commandait un taxi pour l'emmener à la gare de Narbonne.
C'est l'Emile qui allait être content.
JUILLET 2002 – FAMILLE JANSEN
La famille Jansen, venant d'Amsterdam (Pays-Bas), est composée des quatre personnes suivantes :
Annekee Jansen, la mère, 42 ans, resplendissante de blondeur et d'énergie, employée dans une banque internationale.
Joost Jansen, le père, 45 ans, cadre supérieur dans une banque internationale, longtemps défenseur absolu du libéralisme économique, un peu moins depuis que pèse sur son poste une menace de licenciement. Reste bel homme malgré une légère calvitie naissante.
Jade Jansen, la fille, 19 ans, aussi belle que sa mère avec la jeunesse en plus, fera en octobre prochain son entrée à l'université.
Jasper Jansen, le fils, 15 ans, grand et beau jeune homme en plein développement physique.
Statistiquement parlant tous les membres de cette famille sont donc plutôt beaux et trois d'entre eux ont des noms et des prénoms commençant par la même lettre.
Jusqu'à cette année 2002, et ce depuis une quinzaine d'années, la famille Jansen avait pour habitude de passer ses vacances à Benidorm, en Espagne, mais l'année précédente, Annekee Jansen avait eu une aventure (oh une toute petite aventure, une aventure de rien du tout mais tout de même une aventure) avec un serveur de restaurant répondant au prénom de Diego. Joost Jansen en avait pris ombrage et avait décidé que les vacances en Espagne c'était terminé, terminé de chez terminé, et que l'année prochaine ils iraient ailleurs.
L'année prochaine étant survenue, l'ailleurs s'était concrétisé dans cette location à Narbonne-plage, ce dont personne n'avait trouvé à redire, même pas Diego qui avait depuis longtemps oublié son hollandaise lubrique dans d'autres bras accueillants.
Dès les premiers jours de vacances, les Jansen prirent pour habitude, au retour de la plage, de s'arrêter boire l'apéritif au Miramar, un café dont la terrasse se trouvait à l'ombre des grands pins de la rue. Et chaque jour le jeune serveur faisait tout son possible mais sans grand résultat pour arracher son regard au décolleté plongeant offert par le maillot de bain de Jade, sous lequel décolleté, mince et bien vaine barrière de tissu, s'éployait une poitrine rebondie, exactement dans le genre de celles qu'il aimait – c'est à dire à peu près toutes.
Malgré l'apparente distance sociale entre eux, ce qui devait arriver arriva. Jade trouva le garçon gentil et attentionné, le garçon vit en Jade une des plus belles filles qu'il pourrait jamais conquérir ; ils se retrouvèrent un après-midi dans une pinède proche de la mer, les corps alanguis sur un matelas d'aiguilles de pin.
Mais le gentil garçon de café avait une gentille sœur à peine plus âgée que le gentil frère de Jade. Le matelas d'aiguilles de pin se trouvant suffisamment large pour accueillir ce petit monde avide de sensualité, chacun fit son affaire pour son plus grand bonheur. Les vacances sont aussi faites pour ça, se fabriquer des souvenirs et peut-être, qui sait, des regrets.
Pourtant, à son grand étonnement le garçon de café découvrit à l'instant crucial que sa réserve de préservatifs était épuisée. Vide la poche, en dehors d'un emballage, vide lui aussi. Il était trop tard pour reculer. Sa Hollandaise était là, pantelante, liquide, à demi dénudée, l'appelant de tout son corps, de toute la puissance de ses sens, il ne pouvait pas se relever d'un coup en lui disant «Oups, sorry baby i forgot my condoms, bye...» Non, une Hollandaise comme ça, de classe internationale, une hollandaise si hollandaisement hollandaise, ça ne se loupe pas, ça ne se laisse pas passer, une Hollandaise avec autant de trésors disponibles à portée de main, on n'y renonce pas, c'est tout. Alors le gentil garçon de café sortit l'emballage vide de sa poche, s'écarta légèrement de sa compagne et fit semblant de faire ce qu'il aurait dû faire en vrai.
Juste semblant.
Une Hollandaise n'ira jamais vérifier, pensa-t-il.
Effectivement la Hollandaise ne vérifia pas et se donna sans retenue au gentil garçon de café.
Jusqu'à la fin du mois de juillet le frère et la sœur Jansen se rendirent tous les jours dans la pinède à la rencontre du gentil garçon de café et de sa soeur – sans que l'incident du préservatif ne se reproduise.
Jusqu'à leur retour en Hollande, les parents ne surent rien de cette aventure – et de retour en Hollande, l'absence de règles n'inquiéta Jade que lorsqu'elle fut prise de nausées tous les jours au réveil.
Décidément, pensa le père dans un premier temps, il ne faut jamais faire confiance aux garçons de café ;
décidément, pensa-t-il ensuite, il va encore falloir changer de lieu de vacances l'année prochaine.

JUILLET 2003 – CHRISTELLE ET MICHAEL FRUEHAUF
Michael n'aime pas sa femme. Il s'est marié, plus pour satisfaire aux convenances, répondre à ce que la société attend d'un homme de son âge, que par conviction.
Christelle, ce qu'elle veut , c'est un enfant.
Michael ne veut pas d'enfant, surtout d'une femme qu'il n'aime pas.
Christelle a accepté ces vacances en pensant que ce serait le lieu et le moment idéals pour faire un enfant.
Michael a programmé ces vacances dans le but de tuer Christelle.
Christelle est une belle femme, la plupart des hommes la détaillent avec insistance, font glisser leurs yeux sur son corps avec envie.
Michael ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à aimer cette femme si belle.
Christelle n'a pas choisi Michael, Christelle ne choisit jamais rien, elle a pris le premier qui lui a manifesté plus d'intérêt que les autres.
Michael se demande comment il a pu en arriver à l'idée que la seule issue possible était la mort de sa femme. Une idée absurde mais qui maintenant est là et occupe toute la place en lui, pourtant il n'a pas de haine envers Christelle – c'est juste qu'il n'a pas non plus d'amour.
Christelle se demande si elle arrivera à aimer son enfant.
Ce que Michaël avait pris pour de l'amour, au début de leur liaison, n'était que l'incendie allumé par le corps de Christelle.
Michael s'est sermonné, on ne tue pas les gens comme ça, juste parce qu'on ne les aime pas, mais c'est la seule solution qu'il a trouvée.
Christelle semble glisser au dessus de l'existence, rien n'a de prise sur elle, ni les bons, ni les mauvais événements, peut-être un enfant la fera-t-elle changer.
Michael a loué un bateau, il veut partir très tôt un matin, disons lundi prochain, le 9 juillet, tant qu'il fait encore nuit. Une fois en mer il assommera Christelle et la jètera à l'eau. Simple et efficace.
Après il ira dire à la police que sa femme a disparu.
Après il sera libre.
Christelle se pare de sous-vêtements de grande classe et s'exhibe chaque soir devant Michael, en une pose lascive, mais c'est à peine s'il lève les yeux de son roman.
Pour Michael, le meurtre est plus facile que l'aveu de désamour.
Christelle ne s'étonne pas, le 9 juillet au matin de devoir quitter si tôt la maison, en règle générale, Christelle ne s'étonne de rien.
Michaël, en arrivant au port, s'étonne, lui, grandement, d'y trouver une bonne centaine de policiers – dont un certain nombre, bien entendu détaille au delà du raisonnable les courbes de Christelle – en train d'embarquer sur des vedettes.
Selon ses plans il ne devait y avoir personne.
Christelle distribue des sourires.
Michael se sent obligé de voir un signe à cette présence policière.
Christelle et Michael vont en mer voir le soleil se lever. En rentrant au port, Michael annonce à Christelle son intention de la quitter.
Comme tu veux, dit Christelle.
Michael et Christelle sont soulagés.
JUILLET 2004 à JUILLET 2011 – BERNARD ALBERT
Bernard Albert aime ce moment de l'année plus que n'importe quel autre. Non pas parce qu'il est en vacances, ou qu'il peut se reposer, mais parce quetout le monde est en vacances, et qu'il y a dans l'air une atmosphère différente, comme un air de liberté – de fausse liberté, peut-être, mais de liberté.
Et aussi, surtout, parce que ses potes sont loin.
A cinquante et un ans, la vie d'Albert, lorsqu'il n'est pas en villégiature sur la côte, est réglée par les vannes de ses camarades de travail. Il pourrait les énoncer avant qu'elles ne soient prononcées. Par exemple, à dix heures, au moment de la pause café, il y en a toujours un pour dire : «Allez les gars, dans six heures on ferme ».
Toujours.
Ou encore, dès qu'une femme jeune et belle entre dans le magasin, ce qui est plutôt rare, il faut bien le dire, il y a en toujours un pour murmurer : « Celle-là, je lui regarderais bien de près la marque du soutien-gorge ».
Toujours.
Comme si une femme jeune et belle pouvait se laisser regarder le soutien-gorge par l'un de nous, pense souvent Albert. Nous qui sommes gris. Eh, vous vous êtes vus les gars ? Regardez-vous une minute, vous avez vu comme nous sommes ? Nous sommes petits, habillés de blouses grises et nous marchons les épaules voûtées à cause, vous savez bien, à cause du plafond de l'arrière boutique qui est trop bas et qui fait que jamais nous ne nous départissons de cette rondeur du dos, comme si nous le transportions avec nous dans toute la boutique, ce plafond trop bas.
Ce qui fait que jamais une femme jeune et belle entrant dans le magasin ne s'est intéressée à l'un de nous.
Jamais.
Mais c'est un rituel, et comme tous les rituels, y déroger serait sacrilège. Alors il y en a toujours un qui se sacrifie, celle-là, je lui regarderais bien etc.
Voilà pourquoi Bernard aime les vacances, parce qu'il ne voit plus ses petits camarades qui, au bout de vingt cinq ans de vie laborieuse, commencent à lui peser au delà de tout. Plus que le plafond de l'arrière-boutique.
C'est peut-être à ça que servent les vacances, enlever ce poids.
Cette idée, alors qu'il vient à peine d'ouvrir la maison et d'y poser pour la première fois les valises, le 2 juillet 2004, cette idée le fait sourire. De même le fait sourire l'idée que quand Popaul arrêtera de picoler il ne confondra plus les boulons de 8 et de 12. Mais Popaul n'arrêtera jamais de picoler, pourquoi il arrêterait maintenant ? C'est pas quand la quincaillerie va fermer qu'il arrêtera de picoler Popaul. C'est un dur, Popaul, il a même fait de la prison quand il était jeune. C'est en sortant qu'il a commencé à picoler, d'ailleurs.
En dehors de ça, et pendant ces cinq mois de juillet courant de 2004 à 2009, Bernard Albert occupe toutes ses journées de la même façon et selon un emploi du temps extrêmement précis. Lever à 9 heures, plage à 9 heures trente, retour à 11 heures, lecture du journal, repas à 12 heures précises, chez lui, jamais au restaurant, sieste, tour de France, plage vers les 17 heures, apéritif au Miramar à 19 heures, retour à 20 heures, repas chez lui, jamais au restaurant, promenade sur le port à 21 heures, retour et coucher à 22 heures.
Ce que ses potes appellent les vacances de rêve d'Albert.
Jamais Albert n'approche une femme ni n'essaie de lier conversation avec elle ; jamais Albert ne sort le soir dans des endroits où il pourrait en rencontrer. Il entend à longueur d'année trop d'histoires de femmes embarrassantes et revêches ; trop d'histoires pour avoir envie d'une femme. A se demander pourquoi ses potes sont mariés.
Si leurs femmes entendaient ce qu'ils disent d'elles.
Albert fait celui qui compatit, mais ces femmes, au fond, elles ont du mérite à supporter des types comme eux.
Albert sait de quoi il parle, il a été pareil, autrefois.






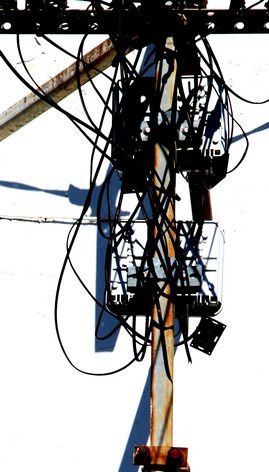


















![9782356390639[1]](http://img.over-blog.com/218x300/4/34/86/74/9782356390639-1-.jpg)