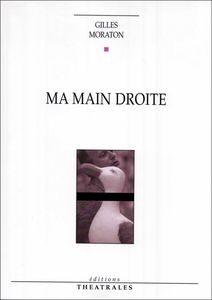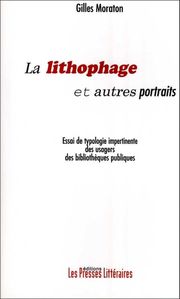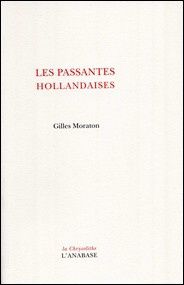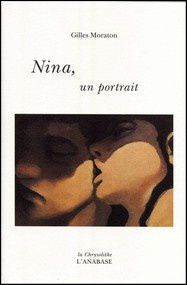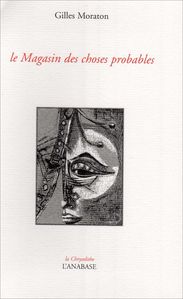VIE DE GIUSEPPE DALLACONTA (ALEZIO, ITALIE)
I - LA GENÈSE
Giuseppe Dallaconta avait pourtant un père énergique et brillant qui eut l'idée, pour sortir sa famille de la misère, d'investir un petit héritage dans l'achat d'une ambulance – un magnifique Fiat 614 tout en bois –, et par voie de conséquence, de faire métier d'ambulancier.
Au début des années trente, dans les Pouilles, il n'était pas facile de trouver une ambulance, et devant ce manque criant, le père n'avait pas eu besoin d'une étude de marché – seulement du constat que nombre de gens mourraient ou se retrouvaient estropiés faute d'avoir été secourus à temps. On ne peut pas dire que cela lui permit de s'enrichir mais au moins n'eut-il pas à émigrer comme beaucoup de sa génération. Les Dallaconta arrivaient à vivre à peu près décemment grâce à ce véhicule – par ailleurs, personne dans la famille, jusqu'à ce 30 septembre 1931, n'avait relevé le côté particulièrement stupide de Giuseppe, premier né d'une fratrie de sept enfants
Le 30 septembre 1931 M. Dallaconta père fut appelé sur les lieux d'un accident de la route, entre Casarano et Racale, dans lequel accident se trouvait impliqué le podestà de Calabre lui-même, personnage éminemment influent dans le sud du pays puisque faisant et défaisant selon son bon vouloir les destins de ses contemporains.
Mais l'ambulance requise n'arriva jamais – ne put même pas démarrer, car le petit Giuseppe avait voulu s'assurer que la rumeur qui courrait et qui prétendait que le sucre empêchait les moteurs de fonctionner était une ânerie. Si le sucre était bon pour le corps, il l'était pour les moteurs, ce qui est bon pour un être humain l'est, a fortiori, pour une mécanique. Ainsi fonctionnait le cerveau du petit Giuseppe – et le podestà mourut dans les bras d'un carabiniere, sur le bord de la route. Peut-être le podestà serait-il mort malgré l'arrivée de l'ambulance, cela, on ne le saura jamais, mais il mourut sans l'ambulance et cette mort fut mise sur le compte de l'incompétence de l'ambulancier.
Le père ne se releva jamais de l'affront ; il aurait pu, à la rigueur faire réparer le moteur mais il était certain, devant la colère des autorités, qu'il ne pourrait plus travailler normalement. Une voiture en panne est une voiture en panne mais hélas le fils Dallaconta n'était pas le seul idiot de la région et il fallu à cet incident trouver un responsable, ce fut le père de Giuseppe qui paya pour l'imbécillité de son fils. En conséquence, il préféra jeter l'éponge en traitant Mussolini de « pantin stupide à la solde du capitalisme » au cours d'une réunion publique. Le lendemain il était enlevé et on ne le revit plus dans la région – il fut déporté et mourut fin 43 dans un camp allemand où il avait été envoyé sous l'étiquette de communiste.
Ces événements ne mirent pas pour autant un terme aux frasques idiotes du petit Giuseppe.
II - L'ÉCLOSION
Heureusement pour lui, la stupidité du jeune Giuseppe l'empêcha de culpabiliser – il ne fut pas en mesure dans un premier temps, d'établir un lien entre son acte (le sucre dans l'ambulance) et la mort de son père. Il poursuivit donc sa vie comme si de rien n'était, conforté en cela par un environnement qui lui-même ne brillait pas par son ouverture. A la disparition de son père, ce dernier chuta même encore plus bas dans l'estime du fils. Il était le seul, le jeune Giuseppe, – le seul – dans un rayon de plusieurs kilomètres, voire de plusieurs centaines de kilomètres, le seul peut-être dans toute l'Italie à avoir été doté d'un père antifasciste. La honte absolue. Car disparaître comme ça à la suite d'une réunion publique ne pouvait signifier qu'une chose : le père était allé trop loin dans sa critique du Duce. Et lui, Giuseppe, à quatorze ans, n'avait plus désormais à choisir entre les deux pères que le sort lui avait fait échoir ; n'avait plus de motif de déchirement entre ce père honni mais génétique, celui qu'il était bien obligé de qualifier de « vrai » et l'autre, celui qui occupait toute la place dans son cœur, mais hélas putatif, le chef suprême père de toute la nation, Benito Mussolini lui-même.
Dès lors, comme s'il voulait racheter les erreurs de son père génétique, Giovanni se jeta corps et âme dans son amour de la patrie et dans l'étude de l'empire romain. Il déploya un tel zèle, une telle ferveur dans son engagement qu'il fut baptisé par ses camarades des balillas, les jeunesses fascistes, Piccolo Duce, le petit Duce, ce qui ne pouvait lui faire plus plaisir. Et Giuseppe se mit alors à passer des heures devant son miroir pour se donner cet air volontariste, mâchoire inférieure en avant et œil vif, que l'on voyait sur le visage du Duce (le vrai) aux actualités cinématographiques. La grandeur du fascisme passait par la mâchoire du Duce – le Christ lui-même faisait piètre figure à côté, d'ailleurs l'avenir n'aurait plus besoin d'aucune religion, ce n'était pas de la propagande, c'était du simple bon sens. A ce rythme-là, bien entendu, le jeune Giovanni grimpa rapidement les échelons de la hiérarchie de sa balilla jusqu'à en devenir un capo, l'un de ses chefs les plus remarqués.
La route, ensuite, lui était toute tracée : il n'avait pu combattre pour la conquête de l'Éthiopie, trop jeune d'un cheveu, il partirait défendre la nation et une certaine idée de la liberté contre les rouges espagnols, ces êtres diaboliques qui conspiraient à la destruction de l'homme nouveau.
Il partit vers la gloire, auréolé du grade de sergent, construire le monde à son idée.
Nous passerons ici sur quelques frasques secondaires, certes imputables à sa condition d'idiot mais sans conséquences sur l'avenir du monde, contrairement à ce qui survint ce froid début de printemps 1937, au cœur de l'Espagne en guerre.
Les troupes italiennes engagées à Guadalajara du côté des franquistes étaient bien supérieures en hommes et en armement à celles des Républicains, pourtant, après quelques jours de bataille, le 18 mars, les Républicains furent en mesure d'encercler totalement les franquistes à Brihuega.
L'ordre leur fut donné de se replier pour éviter des pertes trop lourdes. Dans la panique générale qui s'ensuivit le sergente Dallaconta eut connaissance du fait qu'ils étaient en train de combattre contre des italiens. Lorsque la chose lui fut officiellement confirmée, et lorsque, apprenant de surcroît que les types d'en face étaient commandés par un Italien, Giuseppe s'assit à même le sol, sonné, comme s'il avait reçu en pleine poitrine le souffle de l'explosion d'un obus. Il y avait donc assez d'italiens antifascistes sur terre pour en faire des unités, des bataillons, des compagnies, des armées ; une armée, ici, commandée par un des leurs, un italien, un type suffisamment brillant pour arriver à ce poste.
Un italien commandant une armée en train de se battre contre les troupes fascistes.
Ce type-là ne devait pas rester en vie, il était à lui seul le symbole de l'infamie.
Giuseppe était un des rares êtres humains alentour à être totalement calme, mais ce calme n'était qu'apparent car en lui montait la colère. Il refusa de battre en retraite et fit monter son groupe au combat. Un groupe contre une armée. Ce n'était pas un geste désespéré, c'était l'expression de la colère du sergent Dallaconta. Pour la première fois de sa vie, le sergent Dallaconta, allait désobéir aux ordres, il allait cueillir ce rouge où qu'il se trouve, après tout ils étaient venus pour ça, se battre.
Son groupe, comme lui pétri d'une geste héroïque de pacotille accepta de le suivre.
L'affaire ne dura que quelques secondes.
Ils furent fauchés, hachés, émiettés par des tirs de mitrailleuse.
Autour de Giuseppe, l'odeur fade du sang se mêla à celle de la boue.
On ne se donna pas la peine, en face, de venir vérifier s'ils étaient morts, le froid, la faim et les bêtes finiraient le travail s'il y en avait à finir.
Giuseppe souffrait. Il avait été touché aux deux jambes, ne pouvait plus que ramper.
Il se mit donc à ramper pour essayer de retrouver ses camarades – s'évanouit après quelques minutes d'effort.
Il fut rapatrié en Italie dans un carcan de plâtre, seul de son groupe encore en vie, sans qu'il sache vraiment à quoi ni à qui il devait cette chance.
Le voyage en bateau l'incita à la réflexion – mais comme on le sait un idiot qui réfléchit peut être plus dangereux qu'un savant avec une arme.
La réflexion conduisit Giuseppe à la conclusion que cette aventure était un signe du destin. S'il se trouvait seul en vie, si les autres étaient morts c'est bien sûr parce que les autres y croyaient moins que lui.
Il n'avait pas fini de montrer au monde ce dont il était capable.





![9782356390639[1]](http://img.over-blog.com/218x300/4/34/86/74/9782356390639-1-.jpg)