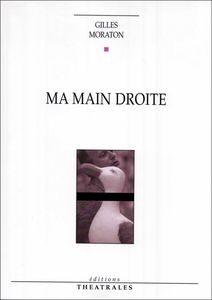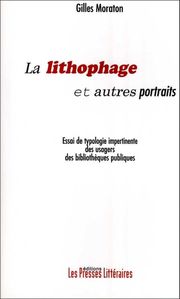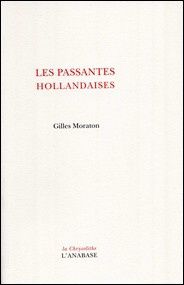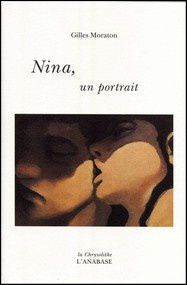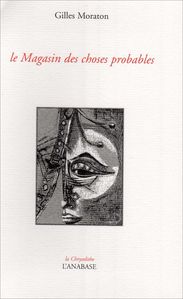UN EXEMPLAIRE DU LIVRE : VINDICIAE CONTRA TYRANNOS, SIVE DE PRINCIPIS IN POPULUM POPULIQUE IN PRINCIPEM LEGITIMA PROTESTATE, STEPHANO IUNIO BRUTO AUCTORE, PUBLIÉ À BÂLE (SUISSE) EN 1579, MAIS PORTANT EDIMBURGI (EDIMBOURG, GRANDE-BRETAGNE) COMME LIEU D'IMPRESSION SUR LA PAGE DE TITRE : SES DIFFÉRENTS POSSÉSSEURS JUSQU'À NOS JOURS.
[AVERTISSEMENT : Au même titre que les autres entrées de l'Inventaire, l'article qui suit, bien que les données bibliographiques soient exactes, doit davantage être considéré comme partie intégrante du champ littéraire que comme source d'information historique]
[NOTE PRELIMINAIRE : Cet ouvrage, dont on pourrait traduire le titre par « Diatribe contre les tyrans » a été mis à l'Index librorum prohibitorum, la liste des livres interdits par l'Eglise romaine dès sa parution. L'auteur n'y remettait pas en cause le principe monarchique du pouvoir mais les abus qu'un monarque pouvait perpétrer dans le cadre de l’exercice du pouvoir. Autrement dit, et pour résumer, il s'agissait d'une attaque violente contre le massacre de la Saint-Barthélémy, dont à tort ou a raison, on attribuait la responsabilité à Charles IX et à sa mère Catherine de Médicis.
Bien entendu, ce nom de Stephano Iunio Bruto est un pseudonyme ; aujourd'hui encore on ne sait exactement qui l'a rédigé et l'ouvrage est attribué à trois auteurs : Hubert Languet, qui toute sa vie a œuvré à l'expansion et à la protection des églises protestantes, Philippe de Mornay (dit Duplessis-Mornay), qui, en tant que conseiller du roi de Navarre, futur Henry IV, aurait grandement contribué à la promulgation de l'Edit de Nantes, ou encore Théodore de Bèze, théologien protestant réfugié en Suisse.
Voilà pour la grande histoire, nous ne nous y attarderons pas davantage, le lecteur averti saura aller puiser chez les véritables historiens les controverses liées aux Guerres de religions.
Il faut pourtant préciser encore qu'un livre mis à l'Index pouvait avoir des destins très différents. Certains y étaient simplement inscrits et tombaient ensuite dans une indifférence molle sans que l'affaire n'enfle davantage ; d'autres pouvaient être brûlés sur un bûcher érigé en place publique, leur auteur et leur libraire – car l'éditeur au sens où on l'entend aujourd'hui n'existait pas encore – poursuivis, condamnés, et emprisonnés.
Tiré à neuf cents exemplaires, l'édition du Vindicae fut saisie sur les terres catholiques et, après l'opprobre jetée à son encontre par l'inquisition, tous les exemplaires saisis furent détruits. Les bibliothèques publiques françaises n'en compteraient que quelques exemplaires, aucun à la bibliothèque nationale d'Italie de Rome, et bien entendu, un exemplaire à la Bibliothèque Vaticane].
1581-1811 : Bibliothèque de l’évêché puis de l'archevêché de Paris.
L'exemplaire qui nous intéresse ici a appartenu dans un premier temps à Pierre de Gondi, Cardinal et évêque de Paris, puis à son successeur, Henri de Gondi, autrement nommé Cardinal de Retz. Il est à noter toutefois que le Cardinal de Retz n'y fait jamais allusion dans ses Mémoires.
Ajoutons que la bibliothèque d'un évêché doit être considérée comme propriété de l'évêque, même si, la plupart du temps les ouvrages sont transmis d'un évêque à l'autre, du moins jusqu'à la Révolution française. Ainsi, celui-ci, bien à l'abri au cœur du système ecclésiastique put-il survivre à tous les interdits pour la raison principale que les théologiens, au même titre que les censeurs, se devaient de connaître ce qu'ils voulaient condamner. La raison accessoire tient au fait que le Cardinal de Retz n'était membre du clergé que pour des raisons politiques, son apostolat ne devant pas grand chose à une excessive ferveur religieuse. Par la suite, nul laïc n'ayant accès à ladite bibliothèque, personne ne trouva à redire à la présence du Vindiciae contra tyrannos sur ses étagères.
1811 : Jean Lemanant.
L'église, alors désorganisée par les caprices de Napoléon, relégua à l'ultime plan de ses préoccupations du moment la bonne tenue de ses bibliothèques. S'ensuivirent même quelques pillages au cours d'un desquels notre Vindiciae fut empoché au hasard sur un coup de tête par un serviteur de l'archevêque, et quitta à jamais le monde feutré et protégé de sa séculaire bibliothèque pour plonger dans le grand monde.
Jean Lemanant avait de toute façon décidé de quitter son office pour s'enrôler dans l'armée napoléonienne et s'en aller lui aussi à la découverte du monde. En arrivant chez lui le jour de son larcin, il jeta le livre dans un coin, lui attribuant pour seule valeur celle d'une ultime prise de guerre ; il embrassa son épouse, s'enivra, s'endormit et dès le lendemain matin s'en alla porter la fureur de la guerre à travers l'Europe.
Jean Lemanant ne revint jamais de la lointaine Russie, le 7 septembre 1812, lors de la bataille de la Moskova, alors qu'il montait à l'assaut d'une redoute, un tir de canon lui emporta la partie supérieure du corps.
L'épouse, à l'instar de son mari ne sachant ni lire ni écrire, encore moins le latin, envoya le livre rejoindre la poussière du grenier, trouvant même stupide cette idée de son mari de choisir un livre comme cadeau d'adieu. Un livre, ça ne servait à rien et ça n'avait jamais rempli l'estomac, si encore il avait pris des fourchettes d'argent.
Notre Vindiciae aurait pu rester à jamais dans son grenier si Grégoire Lemanant, oncle de Jean, n'avait décidé d'occuper le jour même la place encore chaude laissée vacante dans le lit de son neveu. Louise, l'épouse délaissée ne vit pas grand mal à cela étant donné que l'oncle en question était encore en pleine forme et ne donnait pas dans l'ivrognerie comme son imbibé de mari.
Grégoire dénicha vite l'ouvrage dans le grenier et s'empressa de le vendre à un boutiquier qui tenait échoppe près des quais de la Seine pour un franc de l'époque, c'est à dire, l'équivalent d'un kilo de pain environ.
1811-1846 : Henry Pascal de Peyragude
Grand collectionneur de livres sur la Réforme et la contre-Réforme Henri Pascal de Peyragude vient exprès à Paris une fois par an se fournir chez divers boutiquiers de sa connaissance. Parmi ses points de chute figure l'échoppe du bouquiniste Rouart. Cette fois, ce 20 mai 1811, à peine a-t-il fait quelques pas à l'intérieur de la boutique, son regard est attiré par une reliure de cuir sombre, sans nerfs, avec au dos la seule inscription, dorée à l'or fin « Contra tyrannos ». Un habillage sobre typique de l'art des relieurs du 16e siècle. Son cœur se met à battre au rythme d'un cheval au galop, il comprend tout de suite qu'il tient une rareté, il le flaire, il sent ces choses-là à l'instinct, à distance, il ne se trompe jamais. Cependant, ne voulant pas trop se montrer intéressé, il repose négligemment le livre et continue à fureter sur les étagères, l'air de rien. Mais on ne la fait pas à Calixte Rouard, le propriétaire de l'échoppe. Ce n'est pas pour rien qu'il a réussi dans ce métier, il a tout de suite repéré l'étincelle allumée dans l’œil de son client, il a tout de suite compris son petit jeu ; allons s'il la joue fine, il pourra tirer un maximum de l'ouvrage. Il peut même frapper un grand coup, un des plus beaux de sa carrière, s'il se débrouille bien. Il s'approche de l'étagère, s'empare de notre ouvrage, le ramène vers son comptoir, et commence à l'emballer. Aussitôt Peyragude, inquiet, s'approche :
― Je voulais justement prendre ce livre-ci
― Ah mais c'est qu'il est déjà vendu, citoyen Peyragude, voyez, je suis en train de le préparer, l'acheteur doit passer cet après midi.
― Voilà qui est fort désobligeant... Eh bien, quel que soit le prix que vous l'avez vendu, je vous en offre le double.
― Le double ? Holà, et ma parole, qu'en faites-vous ? Il faudrait bien plus que cela pour me la faire oublier.
― Soit, alors... à combien estimez-vous la valeur de votre parole, citoyen Rouart ?
― Disons qu'une bourse pleine d'une centaine de francs ne serait de trop pour me causer des trous de mémoire et me faire supporter le juste courroux de votre concurrent.
Peyragude tire alors une bourse de son habit, la jette sur le comptoir, s'empare de l'ouvrage avec une certaine avidité et sans un mot quitte la boutique. La bourse complète. La bourse initialement prévue pour acquérir et ramener une malle de livres. Cent francs. Peyragude a supporté le voyage depuis Albi, la poussière, la fatigue, les dangers, il a supporté tout cela pour un livre, un seul livre, ce Contra tyrannos qu'il serre maintenant contre sa poitrine en un geste de possession fébrile. Après tout, pense-t-il encore, après tout le voyage de retour sera plus léger qu'à l'accoutumée, et ce livre-là sera la perle de ma collection.
La minute qui suivit le départ de Peyragude, Calixte Rouart ferma son échoppe et s'en alla porter la bonne nouvelle et l'argent en son foyer. Cent francs.
Un livre qu'il avait payé un franc.
Les trente-cinq années suivantes Le Vindiciae contra tyrannos occupa la place centrale dans la bibliothèque du manoir d'Henry Pascal de Peyragude, présenté de front sur un petit lutrin de bois ; nul n'avait le droit de le prendre en main en dehors de la présence du propriétaire des lieux.

1846-1861 : Pierre Estienne
A la mort de de Peyragude, ce fut son neveu, Pierre Estienne qui hérita de sa maigre fortune et de tous ses livres – l'amas de livres, disait-il, car pour lui cela n'était qu'un amas, responsable à ses yeux de la maigreur de la fortune de son oncle. Pierre Estienne vivota pendant deux ans en vendant des livres de temps en temps et puis décida un jour que cela suffisait, au lieu de dépenser le petit pécule du tonton, il devait au contraire le faire fructifier. En 1850 il s'embarqua pour la Cochinchine, « pacifiée » depuis quelques mois, dans le but de s'y implanter et de commercialiser vers la France du thé et du caoutchouc. A force de traîner dans les ports et d'écouter les marins décrire le paradis, l'envie d'abord, puis la détermination avaient grandi en lui jusqu'à le pousser à partir. Il avait alors trente deux ans et avait longuement pesé sa décision, il savait qu'il pouvait gagner une vie extraordinaire dans l'aventure, mais il savait aussi qu'il avait tout à y perdre. Finalement ce fut la conviction qui l'emporta. Il vendit la maison et les livres, et se trouva ainsi à la tête d'un petit capital qui lui permettrait de démarrer. Là-bas, soi-disant, la France donnait la terre à qui la voulait. Il garda toutefois le Vindiciae contra tyrannos, en mémoire de son oncle, et l'emporta dans ses bagages comme un morceau de France.
Pierre Estienne réussit dans la culture de l'hévéa et du tabac, car effectivement la terre était donnée et la main d’œuvre quasi gratuite. Il se construisit en quelques années une vie de planteur, à la fois rude et profitable, exactement le genre de vie dont rêvent les enfants en lisant des romans d'aventure. En 1861 la région de Saïgon, dans laquelle il était implanté, fut ravagée par une épidémie de typhus qui emporta Pierre Estienne. Avant de mourir, n'ayant aucun héritier, il légua sa propriété à un officier de l'armée, Alexis de Berton, avec lequel il s'était lié d'amitié ; il lui transmit également le Contra tyrannos, en lui faisant jurer de ne jamais le vendre.
1861 : Alexis de Berton
Grand catholique pratiquant, royaliste et latiniste émérite, Alexis de Berton trouva pour le moins fâcheux l'héritage de ce livre qui bafouait en même temps les préceptes de sa religion et l'autorité du roi. Garder ce livre chez soi c'était comme inviter le diable à sa table. Une idée impensable, une calamité omniprésente, une farce lugubre, un objet propre à attirer le malheur sur la famille et sa descendance pour des générations, bref une chose avec laquelle il ne pourrait plus vivre dans la quiétude d'un esprit en accord avec sa conscience.
Mais la parole d'un mourant était la parole d'un mourant. Alexis de Bertin était au pied du mur, seul face à lui-même, car ne pas obéir aux injonctions d'un mourant relevait du pêché, il se devait donc, quoi qu'il put lui en coûter, de conserver par devers lui l'écrasant fardeau de ce torchon bourré d'idées fausses et de contre-vérités.
Le dilemme le tortura des nuits entières.
Il s'en ouvrit enfin à son épouse, une femme pleine de sagesse et d'autorité, laquelle lui répondit :
― Il vous a demandé de ne pas le vendre, n'est-ce pas, il ne vous a pas demandé de le garder, qu'est-ce qui vous empêche de le donner ?
Alexis médita longtemps cette idée et puis répondit à son tour :
― Non ce ne serait pas loyal envers un ami, je ne peux pas faire ça, ce serait pire que garder le livre.
― Mais après tout, répondit-elle, si vous le donnez à un ami très cher, ce sera comme si rien ne s'était passé, les amis de vos amis doivent aussi être les vôtres, donc les vôtres sont les siens.
― Ma foi, Ernestine, savez-vous que je commence à percevoir là le début d'une solution ?
― Vous m'en verriez heureuse.
Alexis de Berton trouva le syllogisme audacieux et juste, ce qui lui permit de soulager sa conscience tout en se débarrassant du brûlot protestant. Il le confia avec mille préventions à son ami Adolphe Delay, sous officier, grand éradicateur d'indigènes, lequel eut beaucoup de mal à comprendre le luxe de précautions prises par son ami. Pour lui ce n'était qu'un livre : un objet comme un autre, inapte à modifier la marche du monde, pas plus que sa propre vision de la vie.
1861- 1904 : Adolphe Delay, puis Adélaïde Labattut.
Adolphe Delay ne possédait en tout et pour tout que trois livres dans ses cantines militaires :
-
Traité d'artillerie navale / par le lieutenant général sir Douglas Howard. - Paris : J. Corréard, 1853.
-
Bataille de Preussisch-Eylau, gagnée par la Grande-Armée, commandée en personne par S.M. Napoléon Ier, sur les armées combinées de Prusse et de Russie, le 8 février 1807 : avec trois plans et deux cartes. - Paris : Imprimerie Impériale, 1807.
-
De l'incompatibilité entre le judaisme et l'exercice des droits de cité et des moyens de rendre les Juifs citoyens dans les gouvernemens représentatifs. Par M. Moureau (de Vaucluse), avocat à la Cour royale de Paris. - Paris : Crochard, 1819.
Un livre de plus ne lesterait donc pas ses bagages outre mesure, d'autant, disons-le que c'est à peine si, après être entré en possession du Vindiciae, il y a jeta un coup d’œil. Juste le temps constater qu'il était rédigé en latin et lui faire remonter en mémoire les heures douloureuses passées sur des versions latines, écrasé qu'il se trouvait alors sous le poids de son irrémédiable aversion pour cette langue que plus personne n'utilisait en dehors des curés.
C'est tout juste s'il ne cracha pas sur le livre.
Mais par respect pour son ami Berton il promit de le garder et le rangea avec les lettres de sa mère.
Puis il l'oublia.
Puis il rentra en France pour lutter contre les Prussiens.
Puis il mourut à Sedan.
Sa dernière pensée, voyant monter vers lui un bataillon entier de Prussiens assassins, fut que la guerre avait ceci de stupide qu'elle prenait même ceux qui avaient foi en elle pour établir l'équilibre du monde.
On ne se donna pas la peine de lui tirer dessus, on lui traversa le cou d'une baïonnette et on le laissa là se vider de son sang.
Sa mère ne voulut garder aucun souvenir de son fils tant elle avait pleuré sur cette carrière militaire qui l'avait entraîné vers des pays dont elle ignorait tout. Comme s'il n'y avait pas assez de dangers ici. Elle donna le Vindiciae et les trois autres livres à sa sœur, Adélaïde Labattut qui les conserva comme les reliques précieuses d'un saint vénéré.

1904-1932 : Arsène Langrand
Le 17 aout 1904, par la vertu de ses précédentes épousailles avec Joséphine Labattut, et après le décès du père d'icelle, Arsène et Joséphine Langrand héritèrent du château paternel, du domaine viticole y attenant, ainsi que de la bibliothèque abritée dans le château. Tout à la joie de cette nouvelle condition de nanti, c'est à peine si Arsène Langrand remarqua, de chaque côté de l'immense cheminée du salon d'apparat, les boiseries vitrées derrière lesquelles se dévoilaient des trésors de bibliophilie. Arsène Langland était un terrien, un pragmatique, les livres ne l'intéressaient pas, il ignora donc avoir un jour possédé, puis perdu, puis récupéré, le Vindiciae contra tyrannos.
Le 7 juillet 1920, le livre est dérobé lors d'une soirée par Juste Falicheux, grand adepte de conspirations de toute nature et fervent adhérent de diverses sociétés secrètes parmi les plus en vue du moment – si l'on peut dire.
Juste Falicheux était l'initiateur et le responsable d'une de ces sociétés, celle-ci vraiment très secrète, dont l'objectif consistait à révéler au peuple les voies de la sagesse ancestrale, et à lui dévoiler les arcanes de la conception et de l'avenir du monde. Il lui avait donné pour nom Groupe des sept et en avait lui-même coopté les six autres membres, la seule condition à leur admissibilité étant qu'ils fussent, comme lui mais un peu moins, persuadés de la survenue d'un monde nouveau dont la pierre angulaire serait le chiffre sept.
Sept est évidemment le chiffre magique par excellence : les sept jours de la création, les sept planètes, les sept pétales de la rose, le chandelier à sept branches, les sept trompettes de Jéricho, les sept pêchés capitaux, les sept portes du paradis, etc. Lui-même, Juste Falicheux, vivait au numéro soixante dix-sept de l'avenue des Sept degrés de la perfection, il n'y a pas de hasard.
Accessoirement, le chiffre sept représente la fin d'un cycle de vie et la survenue d'un changement extrêmement positif pour tout le monde. Il suffisait donc que le monde se décille, et Juste Falicheux serait celui par qui viendrait la vérité. Les guerres, les révolutions, les attentats anarchistes, la mise en place d'états à visées matérialistes, tout cela ne représentait que les derniers soubresauts d'un monde qui touchait à sa fin.
Le premier objectif du Groupe des sept était de se procurer un exemplaire du Contra tyrannos et d'en faire une étude approfondie, de lui extirper ses secrets, car le sujet de ce livre n'était qu'une couverture, un leurre, il fallait aller au delà des apparences : dissimulée dans ses pages, ce livre contenait la Révélation, et ils allaient la lui arracher.
Mais remontons quelques mois avant le vol du livre. Le 14 novembre 1919, Arsène Langrand, son ami de toujours avait invité Juste Falicheux à un grand dîner où se trouvait réuni le gratin mondain de leur bonne ville – madame Langrand aimait ainsi de temps en temps exposer sa fortune et faire étalage de sa générosité. C'est au cours de cette soirée, après le repas, que Juste Falicheux, s'ennuyant à mourir, s'empara au hasard d'un livre dans la bibliothèque de son ami. Il s'agissait bien sûr de notre Vindiciae contra tyrannos. Sur le moment il n'y prêta guère attention et le remit en place après avoir jeté un coup d'œil sur la page de titre.
Rentré chez lui, Juste Falicheux se fit cependant la réflexion que, le hasard n'existant pas, il ne s'était pas emparé de ce livre par hasard, il devait y avoir une raison cachée ; il se mit donc à la chercher.
Au terme de quelques heures de recherches, il aboutit au résultat suivant :
-
en accordant à chaque lettre de l'alphabet la valeur numérale de sa position (A = 1, B = 2 etc.)
-
en comptabilisant les lettres du titre,
-
en comptabilisant de même les lettres du nom de l'auteur,
-
en additionnant le tout,
on parvenait, mais oui, au chiffre sept.
Ainsi, avec les lettres de Vindiciae contra tyrannos, on obtenait le nombre 254, lequel nombre lui-même contracté (2+5+4) donnait 11, lequel donnait le chiffre 2.
Avec celles de Iunio Bruto on arrivait à 122, dont la contraction était 5.
2 + 5 = 7.
Le prénom de Stéphano, n'avait été apposé avant Iunio Bruto, c'était une évidence, que pour détourner les soupçons des non initiés. Un piège extrêmement facile à déjouer pour qui sait la vérité.
A partir de là, le Groupe des sept écuma les bouquinistes de France à la recherche du livre. Ils n'étaient pas au courant bien entendu de l'extrême rareté du titre – l'eussent-ils été qu'ils y eussent vu une preuve supplémentaire de la pertinence de leur quête. Mais passons. Après des mois de recherches infructueuses, et malgré ce qu'il lui en coûtait, Juste Falicheux se résolut, lui qui toute sa vie avait été un modèle d'honnêteté, à voler le livre à son ami car, à ses yeux, l'intérêt général du monde passait avant la somme des intérêts particuliers.
Arsène Langrand, peu versé dans la chose philosophique et littéraire, nous l'avons dit, ne se rendit même pas compte de la disparition du livre, une bibliothèque ne représentait pour lui qu'un élément de décoration, ou un signe extérieur de bon goût.
A partir de cette date et pour quatre ans le livre devint donc la propriété du Groupe des sept.

(1920-1924 : Groupe des sept )
Jamais livre ne fut autant lu, parcouru, disséqué, traduit, exploré, analysé, fouillé, dépecé, commenté, que notre Vindiciae contra tyrannos durant les quatre années pendant lesquelles il appartint au Groupe des sept.
Outre Juste Falicheux, le groupe comprenait François-Joseph Beugnon, 53 ans, ouvrier imprimeur, Marcelin Puech, 56 ans, propriétaire terrien, Victor Franquette, 19 ans, sans profession, Joseph Valmaigne, 63 ans, correspondant local de l'Académie des sciences, Danton Teisseydre, 51 ans, cafetier, Marinette Teisseydre, 49 ans, caissière de café.
Il y eut d'abord des études individuelles, chacun voulant être le premier à percer le mystère, mais après sept échecs successifs, on se décida à pratiquer des séances collectives pendant lesquelles chacun lançait les idées les plus farfelues, les plus éloignées en apparence du sujet de préoccupation du groupe pour essayer de décoder le message envoyé par l'auteur. On passa des nuits à compter, à additionner la numérotation pages, d'abord sans tenir compte des erreurs d'impression, puis en tenant compte des erreurs d'impression, on compta et recompta chaque mot de chaque page, puis chaque lettre de chaque mot, on couvrit des cahiers entiers de calculs de toute sorte, on s'acharna à isoler toutes les lettres G du livre, on en mit le nombre en équation, on le divisa par le nombre de pages, par le nombre de mots, par le carré de la distance entre Rome et Jérusalem, puis on fit de même avec le septième mot de chaque page, puis avec la septième page de chaque chapitre, on renouvela l'ensemble de ces travaux en prenant le livre à l'envers, on mesura le livre dans le sens de la hauteur, de la longueur, dans son épaisseur, on combina les résultats les uns avec les autres sans plus de résultat (d'autant qu'on avait ignoré le fait qu'à l'époque de la fabrication du livre on ne mesurait pas en centimètres), on fit encore mille et un calculs tant il est possible de dupliquer et de renouveler à l'infini ce genre d'arguties.
On alla même jusqu'à penser que le secret du livre se trouvait sous le cuir de la couvrure et on s'employa à l'aide des lames les plus fines à décoller le matériau de son support – pour un résultat tout aussi nul que les précédents. Après quatre années de nuits blanches et de recherches de toute sorte, les membres du groupe furent bien obligés de convenir que, si secret il y avait, ils n'avaient pas été capables de le percer. Juste Falicheux traversa donc la douloureuse épreuve de devoir remettre l'ouvrage en place sur les rayonnages de son ami, en sachant pertinemment que personne ne viendrait plus l'y chercher pour lui arracher son mystère.
A aucun moment l'idée n'effleura Juste Falicheux qu'il aurait pu se tromper.
Physiquement, le livre sortit de ces quatre années de tripatouillages dans un état de délabrement que ne lui avait valu, ni son voyage à l'autre bout du monde dans l'humidité de la Cochinchine, ni même ses précédents trois siècles et demi d'existence. Le plat supérieur n'était plus rattaché au corps d'ouvrage que par quelques filaments de ficelle, le veau de couvrure était râpé, élimé, déchiqueté par endroits, des cahiers entiers se détachaient de la reliure, et la dorure même avait été effacée par les frottements répétés de ces chercheurs de l'impossible – mais de tout cela ils se moquaient, ce n'était pas un intérêt bibliophilique qu'ils portaient à l'ouvrage mais un culte mystico-scientiste.
Le Groupe des sept ne sortit pas non plus indemne de l'expérience. A la suite de la folie qui s'empara de Victor Franquette – qui lui valut un internement dans un asile dont il ne sortit jamais –, le groupe décida de se dissoudre, et Juste Falicieux s'en fut porter son besoin d'irrationnel vers d'autres conspirateurs aux visées moins empreintes d'absolu.
Après avoir été remis dans la bibliothèque de son légitime propriétaire, le Vindiciae y reposa en l'état jusqu'à ce que, ruiné par des placements hasardeux et par les répercussions de la crise économique, Arsène Langrand, alors aux portes de la vieillesse, soit obligé de vendre le château et sa bibliothèque.
1932-1952 Augusta & Apollinaire Fichot, puis Helmut & Aloys Loss
Le château fut acheté par un escroc qui pensait avoir atteint le niveau suprême du bien-être après avoir dépouillé des centaines de benêts de leurs économies. Il fut assassiné à peine trois mois plus tard par l'épouse d'un des escroqués dont il voulait faire sa maîtresse. Mais auparavant il avait eu le temps de revendre la bibliothèque dont il ne voulait pas. Dont il voulait même se débarrasser au plus vite. Essentiellement des livres du 17e et 18e siècles. Plus quelques 16e et une poignée d'incunables et de manuscrits patiemment collectionnés par Arsène Langrand. Il y en avait pour une fortune, il en récolta à peine de quoi s'offrir une Alfa Roméo 1930 d'occasion. La bibliothèque en son entier fut achetée par Apollinaire Fichot, un libraire qui possédait un manoir dans la campagne Dijonnaise. Mais Fichot faisait dans le livre neuf et scolaire, les livres anciens intéressaient encore trop peu de monde pour en faire un commerce rentable ; s'il avait acheté ces livres c'était pour son plaisir personnel, et parce que, prétendait-il, la littérature française aurait dû cesser toute activité à la fin du 18e siècle. Son épouse Augusta partageait les mêmes points de vue. Ensembles ils dressèrent le catalogue de la bibliothèque, mirent à part les pièces rares – dont le Vindiciae qui fut ici estimé à la juste valeur de sa rareté –, et firent imprimer un ex-libris qui portait la phrase « Superbiam Burgundi » [Fierté d'être Burgonde] car ils étaient Bourguignons d'origine, et en dessous, joliement disposé en demi-cercle « Pertinet hic liber ad Fichot - Divodurum», [Ce livre appartient à Fichot – Dijon] ; le centre de l'ex-libris était orné de la gravure d'une naïade pseudo-antique aux voiles quasi transparents. Ensuite, patiemment, soirée après soirée, ils collèrent à l'intérieur du plat supérieur de chacun des livres l'ex-bris attestant de sa propriété. Lorsqu'il tomba une deuxième fois sur notre Vindiciae, ne pouvant souffrir plus longtemps de le voir dans ce piètre état, Apolinaire Fichot le porta lui-même avec mille précautions chez un relieur de ses connaissances, Nicodème Trichareau qui tenait boutique à Dijon, rue des Peignes de corne, lequel, découvrant l'objet, ne put réprimer une grimace.
― Vous savez m'sieur Fichot, je suis relieur, pas magicien, ce qu'il lui faudrait, à votre livre, c'est tout refaire.
― C'est bien ce que je suis venu vous demander, maître Trichareau, refaites, refaites.
Ainsi fut-il fait et notre Vindiciae retrouva belle figure, même si, disons le, les techniques de restauration étaient encore tout à fait balbutiantes. Un mois plus tard le Vindiciae réintégrait la bibliothèque du manoir, cousu de neuf, habillé de chagrin vert foncé, et paré dans son dos de quatre nerfs et de pièces de titre de cuir rouge portant fleurons et gravures d'or. On ne peut pas dire que cette reliure était dans l'esprit du 16e siècle mais au moins le livre était-il à nouveau protégé des agressions du monde extérieur pour de nombreuses années.
Huit exactement.
Car lorsque l'invincible armada germanique déferla sur le pays, au mois de juin 1940, Augusta et Apollinaire Fichot furent chassés de leur manoir pour que la Wehrmacht, sous le commandement ici du genaralleutnant Helmut Loss, y établisse son quartier général. Apolinaire essaya de plaider sa cause en présentant au commandant une édition originale en allemand des Souffrances du jeune Werther de Goethe, lequel commandant apprécia la délicatesse mais envoya néanmoins notre homme se faire loger ailleurs sans le moindre scrupule – c'est la guerre, cher ami, et à la guerre le vainqueur a toujours raison.
Contrairement aux propriétaires des lieux, dans un premier temps les livres n'eurent pas à souffrir de cette présence guerrière, le commandant était homme de culture et ne supportait pas que l'on traitât mal ni le vin ni les livres. Notre Vindiciae continua à reposer en paix jusqu'à ce jour du printemps 1943 où Helmut Loss reçut de Berlin l'autorisation de rentrer chez lui se reposer une semaine avant de repartir prendre le commandement d'une division d'infanterie sur le front Russe. Au moment de son départ, herr Loss voulut emporter un souvenir, une prise de guerre, et c'est presque naturellement qu'il se tourna vers la bibliothèque. Il pensa au Goethe, bien entendu, mais son œil fut aussi attiré par la reliure neuve du Vindiciae ; il les empocha et s'en repartit retrouver sa famille dans le centre de Dresde avant d'aller se faire tailler en pièces par les orgues de Staline.
Frau Loss ne fut jamais prévenue de la mort de son mari – de longs mois encore après la capitulation allemande elle gardait l'espoir de le voir revenir, il avait peut-être été fait prisonnier et allait arriver, un jour, les Russes ne pourraient pas garder prisonniers une armée entière, ils avaient suffisamment à faire avec leur propre reconstruction ; il allait arriver et se tenir là, face à elle, dans un long silence. Ensuite ils tomberaient dans les bras l'un de l'autre en pleurant. Mais revenir où ? Leur maison avait été entièrement rasée par les bombardements – comme toute cette bonne ville de Dresde, rayée de la carte –, en dehors des deux livres il ne restait plus rien de leur passé, de la vie de leur famille, plus un meuble, plus une photo, plus un bijou, juste des souvenirs, quelques souvenirs. Les deux livres étaient les seuls objets rescapés du cataclysme, Aloys Loss avait tout fait pour les sauvegarder – elle les avait même tenus serrés contre elle, dans la cave, un soir de bombardement, se donnant l'absurde défi de les protéger pour que son mari revienne vivant.

1952-1991 Augusta Fichot
Le 20 février 1952, au milieu de l'après-midi, Augusta Fichot entendit teinter la cloche de la porte d'entrée. Après la guerre elle avait réintégré le manoir, miraculeusement passé au travers des bombardements d'avril 1944, et restitué à la famille par les autorités.
Augusta alla ouvrir.
Une femme inconnue d'à peu près son âge – une cinquantaine d'années – se tenait là, manifestement gênée, ou timide ; elle prit sur elle pour parler et s'adressa à Augusta avec un fort accent allemand. Aussitôt Augusta se braqua, elle avait juré ne plus avoir aucun rapport avec ces gens.
― Bonjour madame, je suis bien chez monsieur Fichot ?
― Qu'est-ce que vous voulez ?
― Eh bien, je... est-ce que je pourrais le voir ?
― Monsieur Fichot est mort.
― Oh pardonnez-moi, je suis désolée.
― Qu'est-ce que vous voulez ?
― Je... j'ai là avec moi des livres qui vous appartiennent... Je voudrais vous les rendre. Je m'appelle Aloyse Loss.
Tout en parlant elle avait sorti de son sac les deux livres emportés par son mari au moment de son départ. Augusta reconnut la reliure du Vindiciae, et fut aussitôt gagnée par l'émotion, elle avait fouillé et refouillé cent fois la bibliothèque à la recherche de ce livre chéri par son Apollinaire. Elle fit entrer l'Allemande, la fit asseoir dans le salon, alla préparer du café. Le temps de se calmer. Elle revint avec un plateau chargé, emplit les tasses, s'assit face à la visiteuse et lui demanda en la fixant dans les yeux :
― Vous êtes venue d'Allemagne exprès pour me rendre ces livres ?
― Oui.
― Je ne vous crois pas. Il y a autre chose.
― Pourtant c'est vrai.
― Je ne vous crois pas, on ne fait pas autant de kilomètres pour deux livres.
― Vous avez ma parole. Ces livres, je ne voulais pas les garder, ils ne sont pas à moi, c'est mon mari qui les a emmenés, il a dû les prendre ici. Je devais le faire, c'est tout.
― Comment m'avez-vous trouvé ?
― Il y a votre nom dans les livres, et la ville aussi, je suis venue à Dijon et j'ai cherché dans l'annuaire. Il y a deux Fichot, vous êtes la première que je visite. J'ai eu de la chance.
― L'autre c'est le frère de mon mari, il ne vous aurait pas laissé entrer. Et comment se fait-il que vous parliez aussi bien le français ?
― Je... j'étais professeur de français avant la guerre.
― Je vois. Vous aviez tout prévu, c'est ça ?
― Non, je vous en prie, j'aime votre langue, je... ne suis pas seule responsable de cette guerre... mon mari est mort aussi, enfin, il doit être mort.
Augusta sentit que la femme ne mentait pas, elle en était persuadée, et ce qu'elle faisait là en revenant rendre les livres était un acte courageux, elle dut le reconnaître.
Elle le reconnut.
Et, le reconnaissant, ses barrières s'abaissèrent. Sa haine contre un peuple entier s'effritait au seul contact avec un de ses membres. Elle s'en voulut de cela mais c'était ainsi, au delà de sa volonté : elle n'arrivait pas à détester cette femme. L'allemande avait beau être allemande, elle était surtout généreuse.
Un long silence s'installa au bout duquel Augusta murmura :
― Je ne devrais peut-être pas mais je vous crois. Et je vous remercie. Ce livre relié était un des préférés de mon mari, je vous suis reconnaissante.
― Dans ce cas prenez-les, tenez, ils sont à vous.
Augusta prit les livres, les ouvrit, les feuilleta, les tourna en tous sens, très émue, et releva la tête en souriant. Elle rendit le Goethe à sa visiteuse :
― Celui-ci je vous l'offre, vous aurez un souvenir de votre mari.
― Je vous remercie, ce sera la seule chose qui me reste de lui. Maintenant je vais vous laisser, je ne veux pas vous prendre davantage de temps.
― Non, attendez, ce soir vous êtes mon invitée, vous dormirez ici et vous repartirez demain.
Aloys Loss resta au manoir une semaine entière. Au bout de cette semaine les deux femmes, identiques dans leur souffrance, étaient devenues inséparables. Au moment de son départ Augusta fit promettre à Aloys de revenir. Aloys revint l'année suivante, et encore l'année d'après, puis ce fut Augusta qui alla en Allemagne, puis elles alternèrent la France et l'Allemagne pendant des années jusqu'à ce que leurs forces déclinantes ne leur autorisent plus le voyage.
A quatre vingts ans passés, alors que durant toutes leurs rencontres elles n'avaient jamais versé une larme, elles pleurèrent en même temps en voyant, chacune devant son écran de télévision, Helmut Kohl et François Mitterrand main dans la main à Douaumont.
Jusqu'à la mort d'Augusta, en 1991, le Vindiciae trôna seul sur la grande cheminée du salon et bénéficia chaque jour d'un regard, d'une caresse, d'une pensée particulière ; il fut pendant toutes ces années le lien matériel avec son mari, l'objet par lequel elle évoquait chaque jour sa mémoire et son souvenir. Chaque jour aussi elle remercia intérieurement Aloys Loss de le lui avoir ramené.
Depuis 1991 : Possesseur inconnu
Augusta mourut sans héritiers et sans avoir eu le temps d'envoyer le livre à Aloys. Ce furent ses deux neveux qui héritèrent de ses biens. Mais les neveux vivaient loin et avaient construit leur vie, ils vendirent la maison et firent expertiser la bibliothèque.
C'est ainsi que, au milieu de ses congénères précieux le Vindiciae se retrouva mis aux enchères à Paris, à l'hôtel Drouot, lors d'une vente consacrée aux livres anciens.
Deux personnes se disputèrent âprement le Vindiciae : une jeune femme blonde d'une trentaine d'années, en communication téléphonique permanente durant les enchères, et un homme d'une cinquantaine d'année au regard halluciné. Après quelques minutes ils furent seuls à surenchérir l'un après l'autre. Manifestement l'homme ne s'attendait pas à une telle résistance, il avait l'air agacé mais il semblait vouloir le livre par dessus tout. Les enchères grimpèrent à coups de 5000 francs et ressemblèrent rapidement à une lutte acharnée ; l'homme lançait des regards assassins à la jeune femme, mais elle faisait semblant de ne rien voir, continuant à prendre des ordres au téléphone ; la tension était extrême entre eux et, chose rare, la salle faisait un silence complet, comme si se jouait là sous ses yeux un drame shakespearien.
Finalement, c'est l'homme au regard halluciné qui emporta l'enchère pour la somme de 165 000 francs, soit environ 25000 euros, une somme considérable pour un ouvrage du 16e.
La jeune femme se leva et quitta la salle sans un regard en arrière.
A la fin de la vente, au moment où il se levait pour aller payer et prendre possession de son livre, le nouveau propriétaire du Vindiciae s'écroula dans l'allée centrale. La salle fit « oh » et les commissaires se précipitèrent pour lui porter assistance ; l'un d'eux s'exclama « il est mort » ; la salle cria, il y eut un remue-ménage, chacun voulut regagner la sortie au plus vite, un début de panique s'installa. Pendant ce temps la jeune femme blonde avait fait le tour du bâtiment par l'arrière, était entrée dans la salle d'exposition des objets en vente, avait découpé la vitrine où se trouvait le Vindiciae, l'avait dérobé, et était ressortie par la même porte. L'opération lui avait pris moins d'une minute.
C'est ainsi que, l'espace de quelques jours le Vindiciae devint la vedette des médias.
Le lendemain de la vente, Libération titrait, faisant allusion au contenu du livre : « Un meurtre pas très catholique ». Sous le titre figurait un portrait pleine page de la jeune femme blonde. Car elle avait opéré devant toutes les caméras de surveillance de Drouot. L'enquêteur dépêché sur les lieux découvrit une minuscule pointe d'acier fichée dans la nuque du mort ; il en déduisit aussitôt que la blonde filmée avait un complice dans la salle qui lui, (ou elle) était le véritable assassin. Cela ne le conduisit pas bien loin car, malgré toutes les photos diffusées à la télévision et dans la presse, on ne retrouva pas la jeune femme.
La victime se nommait Valentin Capendeguy et n'était pas connu des services de police ; on ne trouva aucun livre chez lui.
Ce que l'on cherche toujours, deux décennies après ce spectaculaire incident, c'est ce qui, dans le Vindiciae, a pu justifier un meurtre.
Les esprits les plus imaginatifs y voient un des avatars de l'après-guerre froide : d'après eux le Vindiciae aurait servi de système de codage d'une liste de taupes soviétiques implantées dans les pays de l'ouest et plus particulièrement en Grande-Bretagne, une sorte de liste noire de tous les agents étrangers. La rareté du livre le rendait difficile à trouver, et rendait par là même cette fameuse liste impossible à décoder.
D'autres, les mystiques, étaient persuadés que le livre contenait la clé du mystère de la vie et de son sens. Un sage bien au dessus du commun des mortels aurait caché dans les pages du Vindiciae la lumière de notre devenir. Des gourous de toute nature vinrent s'épancher à la télévision sur la perte que représentait ce livre pour le bonheur de l'humanité.
D'autre enfin étaient persuadés que ce livre correctement lu aurait définitivement anéanti la religion catholique, qu'il contenait, caché dans ses lignes la raison fondamentale pour laquelle le pape devait être destitué et la hiérarchie catholique remplacée par une église juste.
***
En réalité, rien de tout cela n'a de sens.
Il existe depuis 1979 une réédition du Vindiciae publiée par les éditions Droz à Genève. De nombreuses bibliothèques publiques possèdent ce livre et on peut encore aujourd'hui se le procurer facilement. Le mystère ne tient donc pas au texte lui-même, pas plus qu'à sa rareté.
Il doit y avoir autre chose.





![9782356390639[1]](http://img.over-blog.com/218x300/4/34/86/74/9782356390639-1-.jpg)