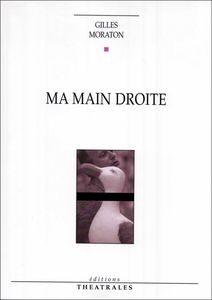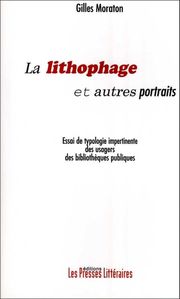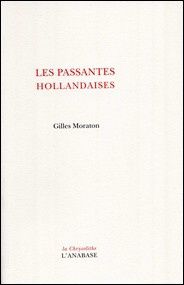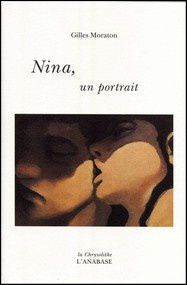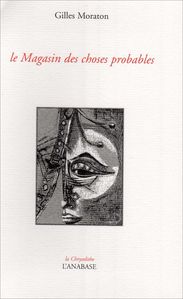PARC DU CHÂTEAU DE PARAZA (AUDE, FRANCE)
I
Dans le parc sonne l'heure de l'attente.
Une statue, bras levé, main tendue, la tête inclinée en un repli de pudeur, guette, séculaire au couchant, la visite quotidienne. La femme vient chaque jour à cette heure, chaque jour lève la tête vers la statue, chaque jour s'arrête, sourit à ce geste immobile qui semble l'attendre depuis des siècles.
A mieux y regarder, le visage de pierre a ce soir comme un air de reproche. Décidément pense la visiteuse, décidément, je me sens de plus en plus condamnée au sort d'une statue de chair – ma locomotion est ma seule différence.
Je voudrais moi aussi pour l'éternité une moue de ce genre.
S'il vous plaît.
Que quelqu'un vienne et fasse ça pour moi.
Une moue de ce genre.
Et lancer ensuite aux vivants mon énigmatique message.
Inutile de convoquer les fantômes, ils sont là, tout proche, et un défilé en procession n'amènerait rien de bon. Ils sont des invités permanent. Alors restons seule de moi à moi, c'est plus prudent, et que les fantômes s'enroulent autour de leur absence de peau et s'en aillent dans les limbes qu'ils n'auraient pas dû quitter, s'agglomérer peut-être aux stratus, cumulus, altocumulus, et retomber ensuite en pluie, mais ailleurs, loin, plus tard, et que cette eau, plus tard encore, ravine jusqu'aux rivières et aux canaux, charriant en même temps que les scories de la terre, les filaments d'un autre monde.
Comme chaque jour la visiteuse reprend sa marche vers les terrasses au dessus de la plaine. Il règne en ce lieu l'absence de temps.
Elle peut jouer aux marquises.
Va même parfois jusqu'à placer un foulard sur ses yeux, et tourner.
Aujourd'hui non ; fait soudain demi-tour, lève la tête vers la statue : « Je ne vous permets pas de me regarder comme ça, pour qui vous prenez-vous ? »
Fige alors son regard sur la main, si fine, si délicate, ce n'est pas la main d'un homme, ça non, une main d'une extrême féminité ; une main de pierre d'une extrême féminité, toute en courbe et en volutes.
Je la regarde mieux.
Elle n'a que moi mais je la regarde mieux que tous les visiteurs de la terre et de l'espace.
Je suis pour elle la preuve de son existence – alors qu'elle n'est pas pour moi celle de la mienne, c'est curieux tout de même cette non-réciprocité, cette gratuité absolue de l'admiration.
Il faudra trouver quelque chose, une moue de ce genre.
Soudain, voyez comme elle est stupide, elle a cru voir la statue élargir son sourire.
Ne cherche pas à savoir, cela suffit.
Un petit mouvement de rien mais un mouvement.
Pour une statue, ça n'est pas rien.
Enfin.
Enfin une première monstration de complicité.
Si elle en avait la force elle monterait sur le socle enserrer dans ses bras la silhouette de pierre.
Les pins cerclant les terrasses
II
Je ne devrais pas descendre, aujourd'hui.
Je devrais rentrer chez moi avec cette image d'elle.
Elle est comme moi.
Non, ce n'est pas ça.
Nous sommes ?
Non plus.
C'est Moi ? Moi seule?
Je suis ?
Alors je suis comme elle.
Impénétrée à jamais.
Pour ça son sourire, regarde, se moquer de toi.
De ta fente soudée, de ton ventre infécond, de ta peau devenue rêche, de ces amours que tu n'as pas eu à donner, éparpillées là, regarde, non, regarde mieux, elles forment un tapis de brisures au milieu des aiguilles de pin, des petits bouts de vie, des possibles, des rognures, et tout cela te regarde en ricanant, au mieux en ricanant, baisse la tête je te dis, regarde mieux, plie-toi vers ce qu'aurait pu être ta vie de femme, ce tapis où le pas s'enfonce mollement.
Mais le fer dans la chair.
Oh oui c'est vrai, la douleur du bâton de l'homme, j'avais oublié.
De cette peau de vieille peau.
Revenons, revenons.
Sous mes pieds les traces du pouvoir, le gravier crisse comme crisse un
gravier de parc de château.
Il règne là le calme des lieux à l'écart.
Les terrasses s'étagent jusqu'au canal. Bassins, jets d'eau, tonnelles fleuries.
Si encore j'avais été laide.
Personne ne connaît la porte secrète pour venir ici, un morceau de grillage à déplacer et à remettre, rien de plus simple vraiment, j'étais soi-disant d'une beauté extraordinaire, les hommes pleuraient de ne pouvoir me posséder et moi je regardais leurs larmes s'écraser à mes pieds, tu te souviens ? et je riais, je leur éclatais de rire à la face, certains en sont devenu fou, certains n'ont pas supporté mon indifférence, se sont inscrits pour un voyage vers la lune.
Vraiment rien de plus simple, c'est comme si ce parc était à moi, mais ce « moi » ne veut rien dire ici. Rien. Nulle part. Personne.
Qui peut se vanter de posséder un arbre ?
Il y en a un qui a quitté sa famille avant même de m'adresser la parole, juste pour me prouver sa bonne foi, son amour, il a mis tout son amour devant moi, m'a fait étalage de son ampleur, m'en a vanté la qualité éternelle, m'a fait tâter la densité de son engagement, de sa résolution, tout cela pendant que moi je riais.
Mes seins ont été durs et fermes je le sais, parfois je m'en suis servi.
Mon parc.
Je suis là dans mon parc. Que ceux à qui ça ne plaît pas viennent à moi. Les terrasses s'étagent mollement jusqu'au canal.
Mollement ?
Mollement.
Jamais je n'ai pris une telle liberté de dire mollement pour une terrasse. Mais mollement. Aujourd'hui, je prends. Les terrasses s'étagent mollement jusqu'au canal.
Aujourd'hui les terrasses sont languides.
Portant haies de buis et buissons taillés.
Il faut.
Car ce lieu appartient.
Avant que la fenêtre s'éclaire.
La fenêtre du grand salon du château.
On pourrait me voir. Il faut que j'aie disparu.
D'une façon ou d'une autre.
Non, il faut que j'aie physiquement disparu avant que la fenêtre s'éclaire sinon.
Je ne veux pas qu'on me voie.
Heureusement.
Heureusement il n'y a pas de chiens.
De ces bêtes dressées contre leur nature à mordre dans le gras des existences et tirer briser déchirer mettre fin sans considération pour le venant-là aucune considération vraiment aucune et le venant-là se sachant chez d'autres ne pouvant rien dire n'ayant rien à dire se sachant dans son tort alors que pas du tout c'est un lieu.
Les pins cerclant les terrasses s'agitent.
Le vent se lève
III
De ces bêtes dressées.
On m'a dit tu ne sais pas ce que tu perds.
Une vie de sexe vide, et ton ventre mieux fermé que par un barrage de pierre. Et moi, moi, mais qu'est-ce que j'en ai à faire vraiment je vous le demande, d'avoir eu ça un jour en moi, cette chose, cette chose que jamais je n'ai osé nommer.
Qu'en pense-t-elle, celle-là ? Elle n'a pas de ces états d'âme, il est dans la nature d'une statue d'avoir le ventre fermé.
Tu pourrais rester là, bras levé, à regarder la plaine d'Aude jusqu'à la fin, personne ne te remarquerait, de toute façon personne ne vient jamais ici à part toi.
Lève le bras voyons.
Oui pas mal voilà ne bouge plus.
Il y a des putes qui bougent autour de la queue d'un homme ça doit faire un drôle d'effet de se sentir pute.
Offerte. Donnée. A la volonté d'un homme.
On me l'a dit.
Et tu l'as cru.
Tu crois n'importe quoi, des femmes que tu connais t'ont dit ça et toi, depuis, tu rêves de ça parfois, alors pourquoi tu ne t'es jamais regardée dans une glace en disant que parfois tu rêvais de ça, te sentir liquide devant un homme, devant la puissance dressée d'un homme, et que parfois tu coules la nuit, tu te réveilles et tu trouves les draps mouillés autour tellement tu rêves de ça, et puis tu te présentes devant la glace comme si de rien n'était, tu le crois ? eh bien oui cela arrive comme ça et tu le sais, seulement maintenant tu es vieille.
Le miroir c'est elle, regarde-la, sa fente de pierre.
Elle ne changera pas, elle, et toi tu n'es pas une statue.
Son bras n'a pas bougé.
Ses lèvres n'ont pas bougé, c'est toi.
Un parc ce n'est pas pareil, un parc il est là, c'est tout.
La fenêtre découpe maintenant des carrés de lumière sur le sol de la terrasse du haut.
Il va être temps.
Il n'y a pas de chien mais des gens peuvent venir, je pourrais toujours expliquer, raconter, mais j'en suis fatiguée à l'avance.
Si fatiguée.
Tout cela ne sert à rien qu'à te faire du mal.
Le monde, autour, se met à tourner.
Et tu es toi au centre du manège, à te complaire dans ta douleur, regardant passer les choses comme au théâtre un spectateur.
Tu t'abandonnes à elle, sans lutter, avec un fond de compassion pour ta petite personne, mais ta petite personne n'intéresse personne en dehors de toi.
Alors si des gens venaient.
Oh bien sûr ils ne jetteraient pas une vieille dehors.
Allons, il va falloir continuer.
Il te reste quoi ?
Les pins cerclant les terrasses s'agitent.
Le vent se lève, il est l'heure pour elle de descendre jusqu'au canal.





![9782356390639[1]](http://img.over-blog.com/218x300/4/34/86/74/9782356390639-1-.jpg)