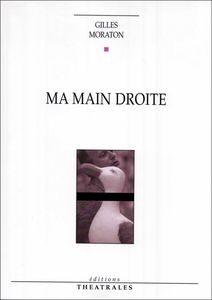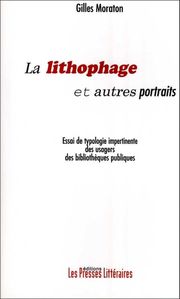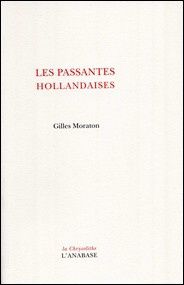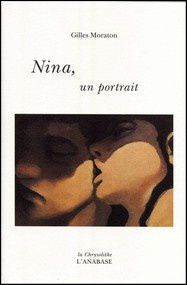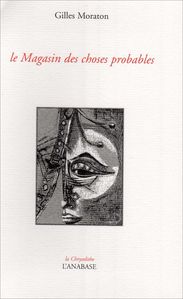UNE JOURNEE DANS LA VIE D'ANDRE CEVAY, CHAUFFEUR DE TAXI A TOULOUSE (REGION MIDI-PYRENEES, FRANCE), JEUDI 28 AVRIL 2011.
André Cevay a cinquante-six ans, il est plutôt petit, brun et arbore au dessus de la lèvre supérieure une fine moustache qui le fait ressembler, lorsqu'il porte un costume, à un dandy des années trente, ou, lorsqu'il est habillé négligé, à un maquereau de ces mêmes années. Sa journée de travail commence à sept heures du matin par une rotation à la gare Matabiau.
Depuis qu'André exerce ce métier, il a dressé une nomenclature des humains à travers leur comportement dans son taxi. André est très fort aujourd'hui, avant même qu'ils posent leurs fesses sur le siège arrière la plupart des clients ont déjà intégré une case de sa classification.
7h00 Gare Matabiau – Rue des auteurs anonymes.
La jeune femme qui s'installe sans un mot à l'arrière n'a pas refermé la portière qu'elle a déjà le téléphone collé à l'oreille. Les gens, souvent, à peine assis dans son taxi, considèrent qu'ils sont isolés du monde – font comme si André n'était pas là, comme s'il était transparent, sans pensées, sans affect, sans existence biologique. Ils pourraient dire à haute voix dans leur téléphone, les gens, qu'ils sont d'accord pour assassiner le président de la République. La jeune femme est jolie, très brune, et ses lunettes de soleil à cette heure de la journée sont déjà un aveu de dissimulation. La demande « rue des auteurs anonymes » claque comme un ordre – et aussi comme une injonction à ne pas essayer d'entamer la moindre conversation. Il y a de ça dans le ton de la jeune femme, conduis et laisse-moi dans mon univers, nous n'avons rien à faire ensemble, seul le hasard nous fait partager ces minutes.
Catégorie des méprisantes, pense André.
Les pires.
Et la rue des auteurs anonymes est à l'autre bout de la ville.
Mais la voiture est un monde clos dans lequel il est impossible d'échapper aux conversations :
« C'est moi, ça y est il est dans le train, j'arrive.
Non, en taxi, c'est plus rapide.
Non.
Non, je te dis, c'est hors de question, on ne sortira pas de chez toi, trop de monde me connaît, ici.
C'est comme ça, c'est ça ou rien.
Mais tu ne le diras jamais n'est-ce pas ? Je suis prête à parier que tu ne le diras jamais.
Non, tu le sais depuis le début, on ne va pas recommencer cette conversation, on l'a déjà eue mille fois.
Ça ne te regarde pas.
Ça ne te regarde pas, il est mon mari, point.
Si tu continues je ne viens pas et on ne se revoit plus, je suis dans un taxi, je peux faire demi-tour quand je veux.
Non ce n'est pas du chantage, tu étais prévenu.
Mais bien sûr que si, comment peux-tu dire des choses pareilles ? Tu... tu crois que je viens juste pour
ça ?
Mais parce que je n'en ai pas envie, c'est tout, c'est ma vie et je la mène comme je veux.
Si, je viens, calme-toi, on en reparle. »
Claquement sec du téléphone, silence.
Dans le rétroviseur le visage ressemble à un masque. Totalement immobile. Totalement fermé. Elle doit avoir le sentiment de traverser un des moments les plus intenses de sa vie.
Mais impossible avec ces lunettes de lire dans ses yeux ce qu'elle ressent.
Il ne se passe plus rien, ces deux personne pourtant si proches poursuivent leur route commune dans une indifférence réciproque.
Au moment où la voiture arrive à destination, quarante minutes plus tard, la jeune femme jette un billet de vingt euros sur le siège avant en disant gardez la monnaie.
C'est bien. Ça devient de plus en plus rare.
La course coûtait dix-neuf euros quarante.
8h05 Rue des Auteurs anonymes – Place des Anges de chair.
Un homme corpulent d'une cinquantaine d'années s'installe et, tout en parlant commence à fouiller dans la mallette qu'il porte avec lui. La logorrhée ne s'arrêtera qu'à la destination demandée, place des Anges de chair, où l'individu à un rendez-vous « super-important ».
Celui-là, pense aussitôt René, celui-là est de la classe des radins. Des radins-idiots, n'ayons pas peur des mots.
-
― Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça ? Vous êtes d'accord avec tout ça ?
― De tout ça quoi ? Demande André.
-
— Bein tout ça quoi, ce bordel dans lequel on nous met avec tout ce qui se passe maintenant.
André ce méfie de ce genre de type, alors il ne répond pas, il a ses idées bien sûr mais il ne répond pas. Dieu que la journée commence mal, conduire un taxi n'est pas le bagne, certes, mais il faut parfois supporter de ces choses...
L'homme reprend :
-
― Moi je dis y'a des solutions simples et personne s'en sert, à croire qu'on est gouvernés par des cons, mais alors de ces cons. Au début j'ai cru qu'il en avait dans le pantalon, l'autre, là haut, mais là, là, qu'est-ce que vous voulez, rien ne change, alors hein. Et puis hé, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, en face c'est encore pire, en face c'est simple ils sont tarés. Moi si j'étais là haut comment que ça changerait. Et rapidos en plus je vous dis pas. J'en trouverais vite des places pour faire bosser les gens, c'est moi qui vous le dis.
André pourrait l'arrêter, il lui suffirait de dire qu'il est payé pour conduire pas pour écouter les délires d'un crétin, mais il ne le fait pas, ça demanderait trop d'énergie, il faudrait renouveler plusieurs fois par jour. Alors il laisse faire en pensant à autre chose.
-
― Non parce que les solutions elles existent, faut pas croire seulement on se bande les yeux, on fait comme si tout ça ne nous concernait pas mais ça concerne tout le monde, faut pas croire, ça nous concerne tous. Et si la police n'y arrive pas pourquoi on envoit pas l'armée ? Vous pouvez me le dire, pourquoi on envoie pas l'armée si la police y arrive pas ? Après tout, l'armée, on la paye, aussi, alors on l'envoie en Afghanistan pour rétablir le calme dans un pays qu'est quand même à six mille bornes d'ici et on est pas foutus de maintenir l'ordre chez nous, vous y comprenez quelque chose, vous ? C'est comme les autres, là, tout le monde dit oh ils sont pas tous méchants, ils veulent pas tous islamiser le pays, mais si qu'ils le sont, ils sont tous comme ça, faut pas croire, ils sont tous pareils, ils veulent tous notre peau, et en plus on leur file du fric à longueur de temps... notre fric... des allocs par ci, des RSA par là... alors que du fric ils en ont tellement qu'ils savent plus quoi en faire, ils font semblant d'habiter des baraques pourries ou des hlm pour endormir notre méfiance, juste semblant, et notre fric, un jour, ils s'en serviront contre nous... ah au moins si on était comme au Etats-Unis où les gens sont armés ça simplifierait les choses, mais non, ici on a des lois à la con, pour nous empêcher de nous défendre... Et pis l'école aussi, faudrait tout refaire, ils ont trop de vacances, et les profs, l'été si on les faisait bosser, au moins on aurait pas besoin de payer autant de fonctionnaires, et pis tous ces jeunes à l'université qui passent leur temps à se branler et à se droguer, quand c'est pas les deux en même temps, je le sais parce que j'ai un voisin qu'à son fils à l'université et qui fait partie d'une petit groupe que nous avons monté avec quelques amis, et dites, ce soir on fait une réunion, ça vous dirait de venir faire un tour ?
André décline l'invitation en se demandant ce que peut bien recouvrir ce terme de « petit groupe » dans son esprit. Ce genre de type finit toujours par péter les plombs un jour où l'autre – la seule vue d'une arme à feu doit lui provoquer des érections. Et peut-être se dit André, peut-être son organisation l'emploie-t-elle à tourner dans des taxis pour les convaincre d'adhérer à leur cause.
Car c'est bien connu, tous les chauffeurs de taxi sont des fachos réactionnaires et primaires.
Et un chauffeur de taxi qui écoute sans entendre ça n'existe pas, un chauffeur de taxi est un être humain comme les autres, il n'a pas la capacité de s'enfermer en soi pour se couper du monde ; l'aspect rigide et immuable qu'il prend parfois n'est pour lui qu'un moyen de défense.
C'est donc avec un certain soulagement qu'André dépose enfin l'individu place des Anges de chair.
-
― Wouaou, douze cinquante, vous êtes sûr ? C'est cher.
André descend du taxi et s'octroie sa première cigarette de la journée.
Ce soir ce n'est pas d'une douche dont il aura le plus besoin.

9h17 – Place des anges de chair – Hôpital de Purpan
Deux hommes en costume gris (le même) et chemise blanche, pas de cravate, s'engouffrent dans le taxi, apparemment ils ont couru.
― Purpan s'il vous plaît lance le premier en s'affalant.
― Coup de bol, ajoute le second...
Après quelques minutes de silence le premier attaque :
― Pauvre Fontanier, il a pas eu de chance.
― Ouais... mais quelle idée aussi de jouer au tennis à son âge.
― Qu'est-ce qu'on va faire maintenant.
― Ce qu'on va faire ?... J'ai déjà réfléchi, figure-toi... J'ai même passé la nuit à réfléchir...
― Et alors ?
― Et alors voilà, on écarte Fontanier, je prends sa place, tu prends la mienne. Simple non ?
― Oh, dis, tu vas pas un peu vite là, il est pas mort, Fontanier.
― Parce que tu crois qu'on peut revenir d'un truc comme ça ?
― Non m'enfin, de là à...
― Non mais attends, on lui crée un poste sur mesure, on est pas des bêtes quand même.
― Ah oui ? Et quel poste on lui crée.
― Bein un poste quoi, on verra le moment venu.
― Et tu crois qu'ils vont valider ça ?
― Bien sûr qu'ils vont valider ça, ils peuvent pas faire autrement, c'est un poste clé, la direction générale, faut bien le remplacer le plus tôt possible.
― OK mais on ne sait même pas ce qu'ont dit les médecins.
― Et pourquoi tu crois qu'on va à Purpan ?
Après un long moment de silence n°2 reprend.
― J'ai une idée... T'sais que la Barthaux de la compta prend sa retraite en décembre ?
― Déjà ? Je la voyais plus jeune.
― On renouvelle pas son son poste et si Fontanier revient il sera pour lui.
― Mh... non non on peux pas, faut quelqu'un de solide à la compta...
Après un instant de réflexion tous deux s'exclament en même temps :
― Les expéditions !
Dans le rétroviseur André les voit se regarder et s'esclaffer. Tandis qu'ils arrivent à destination, numéro 2 reprend :
― Ah ouais, cool les expéditions pour un type qui revient d'un AVC, suffit de superviser les nanas qui collent les étiquettes sur les paquets.
― Oui mais en même temps, répond numéro 1, en même temps je vois mal Fontanier régresser comme ça, même en lui gardant le salaire, c'est un type plus... comment dire, plus...
― Plus ambitieux ?
― C'est ça, plus ambitieux.
― On en reparle ?
― On en reparle.
9h50 Hôpital de Purpan – Rue des pacifistes hargneux
Tandis qu'André passe devant l'arrêt de bus pour repartir vers le centre ville, une femme lui fait signe. La cinquantaine, tailleur sombre, un air de ressemblance avec Nathalie Baye. Le maquillage a coulé sur ses joues, elle a l'air de s'en moquer, elle a l'air de se moquer de tout, elle a l'air complètement perdue. A peine a-t-elle énoncé : rue des pacifistes hargneux, qu'elle se met à pleurer. Elle ne s'arrêtera pas de tout le trajet. André ne sait pas comment réagir à ce genre de situation, il se sent désarmé ; il sent aussi que toute intervention de sa part serait déplacée, il se contente de conduire en silence.
André déteste les courses vers Purpan.

11h10 Hôtel des romantiques libidineux – Gare Matabiau.
Avant de repartir André s'octroie une autre cigarette et quelques minutes de réflexion. Le désespoir de cette femme est bien plus noble que les magouilles des deux cadres de l'aller, il existe donc des gens, encore, qui ont des rapports normaux avec les autres, des rapports d'amour au point de pleurer leur perte prochaine. C'est malheureux pour elle mais rassurant pour la marche du monde... André repart, met la radio sur France Info, apprend que l'événement le plus important du jour est l'attribution des jeux olympiques d'hiver de 2018 à une ville de Corée du sud ; c'est peut-être un grand motif de satisfaction pour les Coréens mais la chose lui semble si dérisoire, mise en balance avec le malheur de sa cliente, qu'il éteint aussitôt la radio. Le standard crachote et lui demande d'aller charger des clients à l'Hôtel des romantiques libidineux.
C'est un camion de déménagement qu'ils auraient dû commander, ces gens, plutôt qu'un taxi ; il doit y avoir là, empilés sur le trottoir devant l'hôtel un bon mètre-cube de bagages. Derrière cette improbable montagne, tous deux bras croisés, un couple trépignant. Après avoir rangé ces bagages dans le coffre du taxi, le couple s'installe dans un silence pesant. Pas le genre de silence causé par la gêne de se trouver avec un inconnu, non, le genre de silence lourd de reproches larvés et de sous-entendus La densité n'en est pas la même – situation aussitôt intégrée à la catégorie des calmes avant la tempête. Après une dizaine de minutes de ce silence, l'homme n'y tient plus :
― Pourquoi tu fais des trucs comme ça ? C'était pas prévu.
La dame, apparemment, n'a pas envie de jouer à ce jeu, elle ne répond pas. Quelques minutes plus tard, l'homme revient à l'assaut :
― Mais enfin, tu ne peux pas interrompre des vacances et partir comme ça, tu ne peux pas.
― Et pourquoi je ne pourrais pas ?
― Parce que. Voilà.
― Dis-donc, ça c'est un argument de poids...
— Si tu veux tout savoir je n'en peux plus.
― Tu n'en peux plus ? C'est nouveau ça.
― Bein oui tu vois, il faut un commencement à tout.
― Et tu n'en peux plus de quoi ? De moi ?
― Toi, tes amis, tes bistrots, tes apéros... je ne voyais pas les vacances comme ça, c'est tout, mais je ne t'empêche pas, je pars.
― Ah oui bein c'est super, je vais passer pour quoi, moi, après ?
― Si je comprends bien je ne te sers qu'à passer pour quelqu'un auprès des autres. Statut indépassable de la femme moderne. Magnifique.
Dans le rétroviseur les visages se ferment.
Ce type-là, pense André en ricanant intérieurement, ce type-là va se la mettre sous le bras pour le reste de ses vacances – car il est également bien connu que les chauffeurs de taxi ne sont pas des modèles de finesse et de subtilité.
11h50 Gare Matabiau - Rue des chacals sur piédestaux
André a repéré de loin la petite vieille avec ses sacs de courses qui l'attend, digne sur le bord du trottoir. Double file devant le Monoprix. Ça devient de plus en plus rare, de ramener les mamies après les courses. André descend, aide à charger les sacs, oh merci mon bon monsieur c'est pas tous les chauffeurs qui font ça.
Après un long moment de silence, André attaque, juste pour parler :
― Vous savez, vous habitez loin, avec le prix de la course vous pourriez largement vous faire livrer chez vous.
― Me faire livrer quoi ?
― Les courses, vous pourriez vous faire livrer vos courses, au lieu de sortir, vous commandez par téléphone et hop ils vous emmènent tout ça.
― Pour quoi faire ?
― Mais... mais pour vous éviter de porter ces sacs, la fatigue, le bruit...
― Oh mais c'est que j'en ai envie, moi, d'être fatiguée, comment je dormirais si je n'étais pas fatiguée ? C'est pas vous après qui viendrez me raconter des histoires pour m'endormir si je dors pas. Déjà qu'avec les cachets j'y arrive pas, si en plus je suis pas fatiguée...
― Oh, je disais ça comme ça vous savez, pour vous rendre service.
― Vous êtes bien gentil je le vois mais moi ça me fait une occasion de parler avec les gens. Les vendeuses, les caissières, les chauffeurs de taxi, c'est pas si souvent. C'est pas quand je pourrai plus marcher que je ferai ça, vous avez des enfants jeune homme ?
André retient le rire cynique au fond de sa gorge, il y a bien longtemps qu'on ne l'a plus appelé jeune homme.
― Oui... oui oui, j'ai deux filles.
― Ah c'est bien ça, c'est bien, elles sont dans quelle classe ?
― Non, elles sont grandes mes filles, elles travaillent toutes les deux et vivent avec des garçons... elles vivent chez elles quoi.
Le silence qui suit semble refléter la perplexité de la vieille dame.
― Ah ? Elles travaillent ? Si jeunes...
― Elles sont quand même pas loin de la trentaine vous savez, je les ai eu très jeune...
― Eh bein, ça m'en bouche un coin, on dirait pas à vous voir... Moi, quand les enfants viennent me voir c'est une fête, je vous dis pas, mais ils sont loin...
Petite conversation insignifiante, des riens raccrochés à des riens, banalités raisonnables, des petits riens dont la vieille femme profite à fond, il le sent bien André, il sent bien chez elle cette avidité retenue par le sens des convenances, il sent bien la soif de communiquer avec les humains, quels qu'ils soient, seraient-ils même des bandits venus la dépouiller, mais tout plutôt que rien, plutôt que l'effrayant silence, le vide. Alors sentant cela, en arrivant à destination André lui tend une carte :
― Tenez madame, la prochaine fois appelez-moi directement à moi, en principe on n'a pas le droit de faire ça, mais ça restera entre nous, hein, et puis on continuera à parler dans la voiture, vous me direz ce que font les vôtres d'enfants, ça m'intéresse.
Et jamais André n'a vu un geste aussi simple, aussi peu porteur de conséquences, un geste aussi quelconque que de tendre une carte professionnelle illuminer un visage à ce point ; il ne sait pas pourquoi il a fait ça, un réflexe, mais ce qu'il sait maintenant, c'est qu'il a bien fait de le faire.

13h45 Jardin des plantes - Place de la nostalgie constructive
Après avoir mangé son sandwich sous les arbres du Jardin des Plantes, André repart vers la gare.
Il est arrêté en chemin par un homme d'une cinquantaine d'années qui demande à être conduit place de la Nostalgie constructive et d'attendre. Il paiera.
Catégorie des malheureux, sans aucun doute, il le porte sur lui.
Arrivé à destination, André laisse tourner le compteur et descend fumer une cigarette, appuyé le dos à la portière de la voiture. C'est un coin qu'il aime bien. En contrebas passe le Canal du Midi. Il voit l'homme descendre les marches qui mènent aux berges du canal et s'arrêter devant un banc où est assise une femme. Ils se regardent sans rien dire. Et puis elle se lève, ils s'étreignent. C'est une belle femme, pour ce qu'André peut voir, car il ne veut pas les observer avec trop d'insistance, fine, les cheveux châtains clairs, la trentaine conquérante. L'homme montre le taxi mais la femme fait non de la tête. Ils se rassoient, il essaie de lui prendre la main mais elle la retire doucement. Ils se lèvent à nouveau, marchent un moment, s'éloignent. La chaleur de ce jour encombre leurs bras de vêtements devenus superflus. Ils sont seuls en pleine ville. N'ont aucun geste l'un vers l'autre. Après quelques minutes, l'homme revient vers André à pas rapides, grimpe les marches quatre à quatre, dit qu'il est inutile d'attendre, qu'il appellera un autre taxi plus tard, demande combien il doit. Dommage, André les aurait bien embarqués ensemble, car il suppose un mystère entre ces deux personnes, et puis il y a tant de retenue dans leur attitude... D'évidence ils ne peuvent que se promener sous les platanes, au bord du basculement vers des actes interdits.
Une supposition, bien entendu, une simple supposition.
En route vers le centre ville la radio de bord crachote la commande : taxi 48, collège du Père Queneau pour 15 heures.
14 h 50 - Collège du Père Queneau - Rue des prudes cercles vicieux
C'est la maman qui a téléphoné d'aller récupérer sa fille de 13 ans au collège, la maman ne peut pas, elle est en réunion et sa fille a des profs absents. La petite est au courant, dès qu'elle verra un taxi elle arrivera.
En fait de petite, André voit monter dans son taxi une filiforme jeune fille qui doit toucher le plafond de la voiture de sa tête.
Catégorie des emmerdeuses.
Le dessus du panier, s'il vous plaît.
Elle ne dit pas bonjour, elle ne peut pas dire bonjour puisqu'elle téléphone à une certaine Vanessa pour lui annoncer qu'une certaine Irvina craint un max parce qu'elle refusé d'embrasser un certain Malcom sous prétexte qu'il bave, alors que Malcom, d'accord il bave un peu, mais c'est quand même le plus beau mec du bahut, avec la même tête, non mais c'est dingue, la même tête exactement que Justin Bieber, mais en brun, et avec des yeux, putain, est-ce qu'elle a vu ses yeux Vanessa ? Des yeux verts à tomber, et les bruns aux yeux verts ça se trouve pas comme ça, et l'autre conne, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle refuse de l'embrasser... si, et devant tout le monde en plus, parce que les garçons jouaient à reconnaître les filles les yeux fermés en leur touchant les seins et celui qui gagnait avait le droit d'embrasser la fille, et t'sais quoi Vanessa, eh bein Irvina elle a pas voulu embrasser Malcom alors qu'il l'avait reconnue quand même, d'accord c'était facile, mais quelle conne quand même, elle aurait été à sa place, ils seraient encore en train de s'embrasser... ouais, et pis elle est pas si canon que ça Irvina, ils exagèrent les mecs, ils sont tous là à la mater comme chais pas quoi alors qu'elle a les jambes toutes tordues, seulement les mecs ils voient que les seins, et les seins d'Irvina, faut reconnaître, c'est les plus gros, même dans les troisièmes y'en a aucune avec des seins aussi gros...
André essaie de fermer son esprit aux inepties débitées à l'arrière, d'autant que le Justin Bieber, il a pas trop de mal à se coiffer le matin, il a juste à passer la tête par la portière d'une voiture en marche.
Allons, allons, se sermonne André, chaque époque a ses icônes, tu as eu les tiennes, laisse-leur les leurs. D'accord, d'accord, je leur laisse, se répond-il, mais quand même, ça fait pas de mal de rigoler de temps en temps.
La rue de la petite est en plein quartier des Chalets, le plus rupin de la ville. La commande portait sur le numéro 12 de la rue, un immeuble cossu du dix-neuvième siècle en pierre de taille, façade refaite à neuf, jardin et tout et tout. A peine arrêté, André voit venir à lui, un... comment dire, une sorte de majordome en gilet noir raide comme un panneau indicateur ; l'homme le paye au centime près, tandis que la petite sort sans un regard en poursuivant son incessant monologue téléphonique. Le décalage entre sa conversation et l'aspect sérieux et bourgeois de la maison et du majordome laisse André perplexe, un court instant.
15 h 40 - Rue des prudes cercles vicieux – Aéroport de Toulouse-Blagnac.
A peine engagé sur l'avenue des Pathétiques-présences-marchant-à pas-lents, un homme, depuis le bord du trottoir fait signe à André. Costume sombre, attaché-case, rasé de près. L’homme s’engouffre dans le taxi et hurle presque : « A l'aéroport, vite s'il vous plaît ».
Catégorie des affairés.
André marmonne, il n'est pas près de mettre en balance son permis de conduire avec un départ d'avion... Mais enfin, il va faire ce qu'il peut, c'est ce qu'il dit à son client :
― Je vais faire ce que je peux, mais si votre avion est dans dix minutes, n'attendez pas de miracle.
― Non, non, bien sûr, soyez prudent... mais vous comprenez si je rate cet avion, c'est ma carrière qui sera stoppée... Je suis... je dois être à Kinshasa demain 16 heures au plus tard.
― Ah... et de Toulouse vous avez un avion pour Kinshasa ?
― Non, bien sûr, je passe par Paris, mais il n'y a qu'un vol par jour pour Kinshasa et si le rate je suis cuit... C'est une réunion extrêmement importante, une sorte de congrès panafricain sur le développement durable... Je... je travaille en free-lance pour l'ONU et j'ai là (il tapote sa mallette) j'ai là un plan formidable pour arrêter la progression du Sahara vers le sud. Pas mal Non ? Vous en avez entendu parler ? Le désert avance de deux-cent cinquante kilomètres par siècle, à ce rythme, l'Afrique entière sera un désert d'ici... d'ici quelque temps. Oh à vous je peux bien le dire, c'est un secret bien entendu, mais comme je vais le dévoiler demain... Le cactus. Vous avez entendu ? Ça en bouche un coin hein quand on dit ça comme ça : la solution c'est le cactus. Il faut planter des millions de cactus le long de la frontière de sable, et au delà des millions d'arbres, il faut couvrir les premiers kilomètres de savane d'arbres de façon à modifier le climat et à faire en sorte qu'il pleuve plus souvent. Pas mal non ?
André est-il donc condamné aujourd'hui à subir sans fin l'égo débordant des clients embarqués ? Il semblerait que oui. Il connaît bien ce genre de clients, André, il sait qu'il ne faut surtout pas acquiescer, ou nier, ou poser une question – ce serait au risque de relancer la machine à palabres pour de longues minutes supplémentaires. Et parfois pourtant, parfois ils n'ont même pas besoin de ça.
― Bon, en attendant bien sûr il faudra trouver de l'eau pour arroser les arbres jeunes mais ça, c'est pas mon problème, je laisserai ça au types de l'hydrologie, ils arriveront bien à détourner un fleuve ou deux, moi j'ai la solution, alors la réunion, je veux surtout pas la rater, si ça marche je fais un carton et l'ONU me garde à vie avec un salaire de cent-cinquante mille euros par an, ah bein oui, ça se paye l'expertise, et tout ça alors que je n'ai même pas le Bac, vous vous rendez compte, monsieur, je me suis fait tout seul moi, j'ai appris dans les livres et j'ai développé mes connaissances au point de devenir indispensable à l'ONU... Alors voyez, l'avion, j'ai pas intérêt de le rater.
― Dites monsieur, votre avion il est à quelle heure ?
― Ah, euh, attendez, laissez-moi regarder ça... voilà, dix-neuf heures cinquante...
― Vous savez qu'il n'est que seize heures dix, là, votre avion, si vous le ratez, je veux bien manger ma voiture.
― Oui bein on n'est jamais trop prudent, n'est-ce pas ?
― Bien sûr, bien sûr, mais ne vous inquiétez pas, d'ailleurs voyez, nous ne sommes plus très loin, vous avez eu de la chance, pas d'embouteillage, vous n'aurez que quatre heures d'attente.
― Ah ah, vous êtes un rigolo vous, hein ?
― A mes heures...
André dépose son client devant la porte des départs et va se ranger dans le file des taxis en attente. Après un petit quart d'heure, il se retrouve deuxième dans la file. C'est alors qu'il voit son client sortir en courant de l'aéroport et s'engouffrer dans le taxi devant lui en hurlant au chauffeur : « Place du Capitole, vite ».

16 h 30 - Aéroport de Toulouse-Blagnac – Hôtel des Marivaudages
André n'a pas le temps d'avancer la voiture que la portière arrière s'ouvre. Deux asiatiques d'une trentaine d'années et un enfant de quatre ou cinq ans environ s'embarquent. Pour ce qu'André en pense, c'est en japonais qu'elles discutent, mais une des deux femmes s'adresse à l'enfant tantôt en japonais tantôt en français. En réalité c'est peut-être aussi du coréen, du chinois ou du vietnamien. Comment savoir ? Comment faire la différence entre des langues où l'on n'a aucun repère phonétique ? Elles sont pleines de vie et de rires, de jeux avec l'enfant, et André, l'espace d'une seconde, se sent exclu, comme à côté de la vraie vie, se sent inutile et vide, finalement à sa place, exactement à la place qu'il devait occuper et qui est celle de servir les autres à longueur de journée, de les conduire où ils le veulent, de leur obéir. C'est là que j'aimerais être pense-t-il, dans l'intimité de ces femmes, dans une complicité avec elles, dans la connaissance de leur vie, dans l'importance donnée à l'enfant, c'est là que j'aimerais être et c'est là où il m'est impossible d'être, si je sors de mon rôle je les perds, si j'y reste, je les perds aussi.
Catégorie nouvelle :celles dont on regrette de ne pas les connaître mieux.
André se sent fatigué de ces rencontres de quelques minutes à peine, de toutes ces vies croisées et oubliées, il en a assez de voir le malheur et le bonheur constamment étalés sous ses yeux, il en a assez de juger, de rejeter ou de s'interdire toute intervention autre que professionnelle.
Pour aujourd'hui, il en a assez d'être chauffeur de taxi.
Devant l'hôtel une des deux jeunes femmes se penche à la portière pour le payer. Elle le regarde droit dans les yeux, d'un regard franc et direct, et André a soudain l'impression que cette femme sait tout de lui, qu'elle a tout compris du malaise qui l'a traversé quelques minutes auparavant. Allons se dit-il, restons sérieux, tu deviens parano mon pauvre.
Elle lui dit :
― Vous devriez vous reposer un peu, monsieur, vous avez l'air fatigué.
Il rend la monnaie sans la regarder, déjà l'enfant la réclame.
17 h 40 - Hôtel des Marivaudages – Rue des petits plats dans les grands.
A l'instant où la jeune asiatique prend la monnaie et s'en va, un homme arrive en courant et demande si le taxi est libre. Allure décontractée, plutôt sympathique.
― Rue des Petits plats dans les grands s'il vous plaît.
― Hein ? Mais la rue des petits plats dans les grands est juste là, à cent cinquante mètres.
― Je sais. Cela pose un problème ?
― Bein non... non non... c'est juste que...
― Je dois arriver en taxi.
― OK, on y va.
Deux minutes plus tard l'homme paie le ridicule écot demandé en laissant un pourboire plus que généreux et disparaît dans la cour intérieure d'un immeuble bourgeois.
Rien à redire.
A ranger dans les maris volages.
17 h 45 - Rue des petits plats dans les grands – Université de Toulouse-Le Mirail.
André n'a pas été appelé par le central, il décide de passer par la gare, il y a toujours du monde à cette heure, ce sera sans doute sa dernière course de la journée.
Effectivement, en arrivant à la gare un homme lui fait signe de s'arrêter, bonjour je dois être à l'Université du Mirail dans quarante-cinq minutes, vous pensez que c'est possible ? Demande-t-il avant de s'installer.
― Vous connaissez Le Mirail ? Vous connaissez le département des sciences sociales ? Non parce que moi c'est la première fois que je viens vous comprenez, je ne voudrais pas me perdre, je sais que c'est grand un campus, je dois donner une conférence à 18h30 dans l'amphi C, vous ne sauriez pas m'indiquer par hasard ? Je me sens... je me sens nerveux, voyez....
― Ah désolé m'sieur, répond André, la dernière fois que j'ai mis les pieds à l'Université, c'était pour livrer une pizza, en 1982.
— Bon, bon, pas grave, je me débrouillerai, y'a juste le début que j'ai pas, le début, je l'ai pas, voyez, je ne sais pas comment placer cette histoire de modération des statistiques par la méthode empirique, ou de pondération de l'empirisme par la méthode statistique, c'est que, voyez-vous, aucune expérience ne peut être bâtie sur la seul foi des statistiques, les statistiques ne peuvent que venir en appui, vous voyez, en appui, c'est pourtant clair, et aujourd'hui, face à la montée des CAC, l'université est déboussolée, chacun campe sur des positions archaïques, plus personne n'ose publier de peur de se faire flinguer en vol, et voyez monsieur comme vous êtes tranquille derrière votre volant, même les sciences pures ont peur de passer à la trape, de voir leur département supprimé, alors pensez la socio, déjà qu'avant les CAC certains disaient qu'on ne servait à rien, d'accord on est mieux lotis que ceux de la littérature comparée mais à peine, vraiment à peine, un poil de plus, et un poil qu'est-ce que c'est dans un ouragan, je vous le demande, pas grand chose n'est-ce pas... autant dire rien... Et moi je ne sais pas par quel bout attraper tout ça, je ne sais même pas pourquoi c'est à mi qu'ils ont fait appel, non oarce qu'en fait quand je disais qu'il n'y avait que le début qui me faisait défaut, ce n'était pas tout à fait juste, en fait je n'ai pas grand chose, je me demande même dans quel pétrin je suis allé me fourrer, dites si vous nous engagiez dans un embouteillage, hein, qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous paierai bien sûr, mais attention, pas le petit embouteillage de banlieue, non, le vrai gros embouteillage qui vous paralyse une ville pendant des heures, genre camion de butane renversé sur le périph, voyez, ou un truc comme ça, bien entendu tout cela est virtuel, il n'y aurait pas vraiment d'embouteillage mais si vous cachiez la voiture avec moi dedans,je pourrai dire en arrivant que j'ai fait tout mon possible, oh mon dieu, maispourquoi je dis des choses pareilles, je dis n'importe quoi, pardonnez-moi c'est la tension, on est bientôt arrivés non ? Tant mieux, donnez-moi du temps pour me préparer, passez par Strasbourg s'il le faut, hein, dites, vous pourriez passer par Strasbourg pour aller à la fac, ça me laisserait un peu de temps, dire qu'ils m'attendent comme le sauveur,à moi, s'ils savaient, j'en sais à peine plus qu'un étudiant de première année, et ils veulent que je fasse jaillir la lumière, que je leur apporte sur un plateau l'idée qui sauvera Ravaillac de la hache du bourreau... les pauvres, s'ils savaient comme je sais peu, car à vrai dire de solution il n'y a point, nous allons être étouffés par ces pseudos-sciences de l'utilitaire, que voulez-vous c'est l'air du temps, comme si un savoir pouvait être utile, j'entends utile au sens où ils l'entendent, c'est un leurre monsieur, de vouloir affronter cet avenir sans l'appui de la sociologie et de la philosophie,mais pour contrer ces idées fausses il faudrait plus que des paroles, et hélas je suis tellement loin des cercles politiques que je ne connais même pas la date des prochaines élections, c'est vous dire, comment, que dites-vous, nous arrivons, oh mon dieu, il fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre, d'arriver, quelles heure est-il ? Dix-huit heures trente-cinq, vous avez fait ce que vous avez pu, je le reconnais, ça me donnera au moins l'excuse du stress, allons, je plonge, nous verrons bien.



















![9782356390639[1]](http://img.over-blog.com/218x300/4/34/86/74/9782356390639-1-.jpg)